01 - La création de toutes choses
L’homme se réveilla en sursaut et en sueur. Une idée ! Il avait une idée ! Il ignora les chiffres rouges de l’antique radio-réveil, qui affichaient trois heures trente-sept du matin, et se rua sur son ordinateur. L’opération était délicate, la très vieille machine devenait capricieuse en plus de mettre cinq bonnes minutes à démarrer. Au moins eut-il le temps de dégager la pile de linge sale (ou propre ? il ne savait plus) qui squattait l’unique chaise de son studio, et d’écraser un trop gros insecte non identifié qui gambadait sur la toile de verre jaunasse du mur.
Clac-clac-clac-clac-clac, le cliquètement frénétique de l’antique clavier résonnait dans la pièce, ponctué de temps à autre d’un juron sonore, lorsque l’une des touches, collée par des restes de soda premier prix se coinçaient en position basse et délivrait une ligne de caractères identique à la place d’une lettre isolée. Des coups de poing sur le mur du fond venaient souligner cette rythmique incongrue, cadeau du voisin réveillé par le vacarme – mais à travers les cloisons aussi fines que du papier, le moindre souffle devient un ouragan.
L’homme, lui, n’avait cure des protestations de son voisin. Il avait une idée. Il avait **l’**idée. Une qui, contrairement à d’habitude, résistait à son éveil sans se décomposer en un tas de n’importe quoi, au point qu’il se demandait s’il ne rêvait pas, justement. Alors, parce qu’enfin il pouvait inventer, qu’enfin il exauçait son rêve, il créait, couchant sur le papier virtuel des idées qui devenaient réalité.
Oh, ce n’étaient que des fragments, des images, une situation, une émotion fugace.
Pop ! Un personnage, paré pour diverses aventures !
Wooosh… un décor, inquiétant et accueillant à la perfection…
Oh ! Une palpitante péripétie prête à partir !
Un Dieu et un Dragon – il faut toujours des dieux et des dragons pour équilibrer un monde.
Et alors que l’aube amenait une lueur blafarde à travers les persiennes défoncées, tout ça commençait à s’assembler, à s’articuler. Des taches de situations devenaient des fresques épiques ; des pièces de personnages inoffensives se regroupaient en héros capables de changer le destin même de l’univers.
L’homme avalait une tranche de pain rassie lorsqu’un royaume s’effondra ; il but un café froid (passé, oublié, réchauffé, oublié de nouveau et plusieurs fois de suite) pendant la naissance d’un empire. Un plat de pâtes au sel escorta une bataille interstellaire de près d’un million de vaisseaux. Quatre coups de téléphone (deux de l’assurance chômage le pressant d’aller à son rendez-vous, un d’insulte d’une ex-compagne), accompagnèrent le dénouement tragique d’une histoire d’amour qui changea l’avenir de trois pays. L’homme chassa d’un geste distrait une souris qui grignotait le restant du pain industriel, il n’avait pas le temps de s’en occuper, car un adolescent découvrait sa haute lignée et ses pouvoirs surnaturels.
Tout son environnement lui hurlait à la face qu’il n’était qu’une merde, un moins que rien, incapable de subvenir à ses besoins. Mais l’homme créait, une gamberge comme un gigantesque doigt d’honneur à cette réalité sordide. L’homme créait, à l’origine de toutes choses, un Univers entier lui devait la vie – était-il Dieu ?
L’homme créait, et il était heureux.
02 - Ce qui est dans le noir
Lorsqu’Emma se réveilla, il faisait noir.
Ce n’était pas ce noir normal, cotonneux et rassurant d’une nuit calme, avec le rai du lampadaire qui filtrait à travers le jour entre les volets, la vague lueur sous la porte, les petites diodes fixes ou clignotantes, témoins de veille de divers appareils électroniques dans la pièce, et parfois encore une veilleuse. Ce n’était pas ce noir que l’on apprivoise pour finir par percer.
Non, c’était un noir épais, opaque, poisseux, absolu, et surtout parfaitement anormal dans cette ville pétulante. Si oppressant qu’il rendait difficile la respiration de la fillette, il était accompagné d’un silence total. Elle n’entendait rien, pas même son souffle ni les battements rapides de son cœur, qu’elle sentait pourtant tambouriner dans sa poitrine, de plus en plus vite. Moins encore que le noir, le silence n’existait pas ici ; la cité remplissait les ténèbres de bruits de voitures, de camions-poubelles, de personnes ivres, et de toute cette catégorie de sons indistincts qui, étouffés par le double vitrage, différenciaient une nuit calme de ce silence de caveau.
Or, il y avait quelque chose, dans ce noir ; quelque chose de moins normal que l’obscurité et le silence lui-même.
La jeune fille prit son courage à deux mains et tâtonna jusqu’à retrouver son renard en peluche – ce coquin s’était enfui presque au pied du lit. Emma adorait ce jouet, en plus d’être supermignon, il pouvait chanter l’Internationale et allumer ses yeux en vert. Ce qui était parfaitement idiot, parce que tout le monde sait que les goupils ont des yeux ambre et pas verts. Elle déclencha donc les yeux, espérant que cette faible lumière écarterait le noir ambiant – la chanson ne paraissait pas adaptée à la situation.
Le résultat n’était pas terrible. Les deux petites diodes arrivaient à peine à souligner l’obscurité. D’un noir absolu, la pièce se retrouvait maintenant dans un noir complet, les quelques lueurs qu’elle parvenait à percevoir ne l’aidaient qu’à comprendre qu’elle n’y voyait rien.
Et pourtant… son doute se mua en certitude. Il y avait quelque chose, là au fond de ce noir, tapi dans l’ombre d’un recoin de la chambre, entre le coffre à jouets et la maquette de fusée.
Que pouvait-elle faire ?
Bien sûr, elle aurait pu hurler et pleurer sa mère, mais elle ne le voulait pas. Elle était grande, maintenant (tout en sachant confusément qu’elle répétait ce mantra depuis au moins quatre ans, ce qui représentait plus que la moitié de sa vie). Et les grandes filles n’appellent pas leur maman pour rien. Alors, quoi d’autre ?
Peut-être pouvait-elle l’ignorer. Mais Emma n’essaya pas de se convaincre, elle ne pourrait pas dormir en sachant cette présence, aux intentions inconnues dans sa propre chambre. Il fallait une solution différente.
Que pouvait-elle faire ? Elle aimait bien et savait bien chanter. Mais quel genre de chansons pourrait apprécier un quelque chose qui se cache dans le noir ? D’ailleurs, s’il se terrait dans l’obscurité, peut-être s’y plaisait-il ? Peut-être qu’il s’intéressait aux planètes et tout ça ? La fillette connaissait plein de trucs sur l’espace, elle pourrait lui en apprendre quelques-uns, peut-être, ou l’inverse ?
Elle braqua les pâles lueurs du renard en peluche vers le coin de la chambre. Elle n’y voyait toujours rien, mais sut que
la chose qu’il y avait là-bas avait rétréci, ou s’était ramassée sur elle-même ? Pourquoi restait-elle dans ce coin ?
Que faisait-elle dans cette pièce, d’ailleurs ?
Alors Emma prit une profonde respiration, tenta de clamer son cœur qui battait la chamade dans sa poitrine, et s’extirpa de sous sa couette. Avec d’infinies précautions (elle ne voulait pas marcher sur un Lego égaré), serrant son jouet contre son sternum, elle s’approcha de l’angle de la chambre. Arrivée près du coffre, elle s’agenouilla – les adultes faisaient souvent ça, s’agenouiller pour parler aux plus petits qu’eux, même avec elle bien qu’elle était une grande, et demanda :
— Dis, chose qui est dans le noir, qu’est-ce que tu fais la ?
Il y eut un bref mouvement brusque. La sirène deux-tons d’un camion de pompier et un rugissement de moteur déchirèrent le silence, tandis que le rayon bleu du gyrophare balaya la pièce. Emma parcourut la chambre du regard ; tout était là, parfaitement normal, d’un calme exquis. Rassurée, elle haussa les épaules et retourna se coucher.
Et, plus tard, quand on s’enquérait de si elle avait peur du noir, elle répondait :
— Moi ? Non. C’est idiot, d’avoir peur du noir. Il suffit de lui demander pourquoi il est là. Et si ça se trouve, c’est lui qui a peur de nous.
03 - L’odeur d’un vieux placard
… et un vieux placard leur montrait sa porte fatiguée, entrebâillée entre la cheminée et le mur mansardé. Bien qu’on avait abandonné cette aile de la maison des années auparavant, les quatre visiteurs avaient chacun leurs souvenirs de cette pièce. Ils parcourent les trois mètres qui les séparaient du rangement.
Marie l’ouvrit avec précaution ; une volute voleta tandis qu’une odeur de renfermé et de cinquante plus tôt lui assaillit les narines. Cette salle avait été sa chambre, à l’époque où elle n’était qu’une enfant. Situé directement sous les toits et très mal isolé, ce cagibi s’était avéré inapte au stockage de quoi que ce soit de valeur. Alors elle en avait fait sa cachette personnelle, y entreposant ses poupées, ses trésors, parfois elle-même pendant de courts moments de bouderie. Il y avait eu aussi cet été-là…
— Marie ! Qu’est-ce que c’est que ça ?
Sa mère désignait une coulure rouge vif qui s’échappait de sous la porte du placard. Zut ! Elle les avait complètement oubliées !
— Heu… ça doit être les cerises.
— Les cerises ? Quelles cerises ?!
— Ben…
La femme ouvrit la porte ; une violente odeur de fruits trop murs emplit instantanément la pièce. Quelques drupes tombèrent, rebondirent et roulèrent sur le parquet dans de petits bruits mous.
— Doux Jésus, Marie, qu’est-ce que tu as fait encore ?
— Eh bien, je voulais être sure d’avoir des cerises tout cet été, alors je les ai gardées là…
— Par cette chaleur ? Mon Dieu…
La jeune fille avait dû nettoyer l’endroit de fonds en combles ; mais les années suivantes, le placard avait conservé
cette odeur caractéristique. Et même aujourd’hui, plus d’un demi-siècle après, Marie la décelait encore, entre les
effluves de renfermé, de moisi et de poussière.
Ça n’était pas une illusion. Elle en était sure… presque sure…
* * *
Georges contemplait le placard, sa texture rugueuse, sa peinture intérieure blanche écaillée, sa senteur de vieux bois surchauffé à travers la toiture sous le soleil d’été que parvenaient à peine à masquer les émanations de renfermé et de poussière. Il avait eu l’occasion d’étudier longtemps tous ces détails, quatre décennies plus tôt. Lui et Marie se fréquentaient depuis peu, à l’insu de leurs parents respectifs (croyaient-ils) quand ils avaient profité d’une absence de ses ascendants à elle pour passer une journée en amoureux.
Le crissement de pneus sur le gravier de l’allée les tira de leurs bécots, la jeune femme se rajusta et se rua à la fenêtre.
— Foutredieu ! C’est Papa !
— Qu’est-ce qu’il fait ici ? Il ne devait rentrer que tard dans la nuit ?
— Je ne sais pas, mais planque-toi, vite ! Il a l’air énervé en plus !
— D’accord, mais où ?
Il était hors de question qu’il trouve Georges là, dans cette chambre, alors qu’ils étaient tous deux mineurs. Le paterfamilias avait des idées très arrêtées sur qui pouvait fréquenter sa fille et de quelle façon, ce que les jeunes gens auraient résumé à « personne, d’aucune manière ».
Pris de court, l’adolescent se terra dans la seule cachette assez grande pour l’accueillir, et cuit dans ce four improvisé jusqu’au soir, quand le paternel s’en fut enfin jouer au bridge. Marie le récupéra en nage, deshydraté et courbatturé ; mais l’incident avait soudé leur couple pour de longues décennies.
* * *
Thérèse sursauta en reconnaissant cette odeur de poussière et de renfermé aux relents de moisi. Lorsque sa mère quitta la maison, après son mariage avec Georges, la pièce avait été reconvertie en partie en bibliothèque. Quelqu’un avait eu l’idée saugrenue de ranger des piles entières de livres dans ce placard, et ce qui devait arriver arriva : un violent orage créa une gouttière qui détrempa les ouvrages.
Ce n’est que plusieurs semaines plus tard que la femme constata les dégâts, intriguée par l’odeur étrange qui flottait dans la salle. Elle insista pour s’occuper du problème, malgré les récriminations de ses grands-parents. Protestations qu’elle ne comprit qu’en découvrant la nature exacte des documents stockés là. De toute évidence, ses ancêtres à la réputation empesée appréciaient la littérature qu’ils auraient qualifiée de coquine.
Une collection impressionnante qui était si détériorée qu’elle avait fini dans une poubelle discrète ; mais la représentation que se faisait Thérèse de ses aïeux en avait été changée à jamais.
* * *
Jules, intrigué par l’odeur de vieux papier et de plastique antique qui se dégageait du placard, en extirpa une boite de jeu. L’objet était en ruine, les coins ne tenaient plus qu’avec du scotch. Il manquait un bon quart des cartes et les billets de banque étaient tous en vrac, mais avec un peu d’effort, assez d’imagination et de mauvaise foi, on pourrait quand même y jouer.
Le jeune homme connaissait bien ce jeu pour en avoir fait d’innombrables parties avec son grand-père lorsqu’il était enfant, une dizaine d’années plus tôt. Maintenant, il devait reconnaitre que le jeu ne proposait qu’un amusement très limité. Mais il voyait le regard pétillant du vieillard se poser sur la boite…
— Ça te dit une petite partie, Papi ?
Oh, et l’ancêtre trichait comme un porc. Enfant, il n’avait jamais rien vu, mais l’avait compris adolescent. C’était l’occasion de prendre une revanche méritée. Tiens ? Un antique illustré mangé par les moisissures trainait dans le fond…
04 - Cette vague impression que quelqu’un vous regarde par la fenêtre
L’extinction toute en douceur des lumières entraina avec celle des murmures qui bruissaient dans la salle. Et ce fut ce silence particulier de trois-mille-deux-cents respirations toutes retenues en même temps : enfin commençait, dans le plus grand cinéma du continent, cette avant-première tant attendue.
Sur l’immense écran, un plan fixe sur une chambre au luxe impressionnant, mais désuet. Un Asiatique en pyjama bordeaux s’admirait dans l’un des miroirs. Dans le lit king size, deux charmantes jeunes femmes gloussaient. Pas de musique. Satisfait de l’apparence de son reflet, l’homme se retourna, détailla la garniture de la couche, sourit et s’approcha.
La voix bipartite d’un doublage simultané résonne dans le cinéma.
— Bonsoir, mes chéries. J’espère que vous m’avez préparé quelque chose de calme ce soir, je suis d’humeur tranquille.
Pour toute réponse, les demoiselles poussèrent de nouveaux petits rires. Un projecteur révéla le maitre de cérémonie, debout sur scène dans un coin de l’écran. Une autre diction, la sienne, commenta la vidéo.
— Mesdames, messieurs, la Compagnie Générale de Télétransmissions vous l’avait promis ; personne ne l’avait cru, les physiciens nous avaient dit que c’était impossible, et pourtant le voici sous vos yeux ébahis : les images de la planète Vissi, en direct et en exclusivité internationale pour vous et rien que pour vous.
À l’écran, l’homme se glissa avec délice entre les draps de satin de soie repassés, savourant les effluves de linge propre et de parfum des femmes.
Dans la salle, des applaudissements dubitatifs, et quelques regards appréhensifs de parents qui, ayant amené leurs jeunes enfants à cette première mondiale, s’inquiétaient du tour que pouvait prendre le scénario proposé.
— Mais vous n’avez rien vu !, s’exclama de nouveau le maitre de cérémonie. Malgré les années-lumière qui nous séparent de cette scène en direct, malgré les milliaaaaards de kilomètres, nous avons réussi à capter le son. Nous avons pu obtenir l’image – et une image d’une qualité remarquable, comme vous pouvez le constater.
Un gros plan sur le visage de l’une des femmes, occupée à émoustiller le pyjama, appuya cette affirmation.
— Mais il y a mieux ! Nous suivons ici un spécimen et ses deux compagnes, tableau fort charmant, mais qui risque de devenir inadapté à notre jeune public. Or, notre système permet de suivre plusieurs modèles et ce en simultané !
La scène à l’écran se fondit et enchaina sur une pièce austère, dans laquelle parlaient trois hommes, asiatiques eux aussi. C’était le genre de salle dont la sévérité, conçue par un escadron d’experts, dégageait un luxe plus impressionnant que n’importe quelle dorure. Loin sous les immenses baies vitrées, une ville trépidait dans la lumière rouge du soir.
Des applaudissements conséquents retentirent dans le cinéma, ponctués par quelques huées.
— Nous tombons donc d’accord : l’élimination physique de monsieur Wang est la seule option disponible, dit le plus petit.
— J’ai hélas épuisé les solutions légales, répondit le chauve.
Le troisième, obèse, rajusta son impeccable veste de costume bleu nuit avant de continuer.
— Les solutions vénales sont épuisées aussi.
— Très bien. Messieurs, je planifie l’opération pour mercredi onze. Nous avons une semaine pour nous préparer. Nous ne nous reverrons pas d’ici là.
Ils s’inclinèrent, le chauve et l’obèse partirent chacun par une porte. Le petit resta seul, absorbé en apparence dans la contemplation de la ville à ses pieds.
Le maitre de cérémonie reprit la parole.
— Mais il y a encore mieux ! L’idéal à ce stade du scénario ici serait de savoir ce que pensent nos protagonistes, n’est-ce pas ? Eh bien, malgré la distance littéralement astronomique, malgré les difficultés techniques réputées insurmontables, la Compagnie Générale de Télétransmissions a rendu cette prouesse possible. Mesdames, messieurs, rien que pour vous ce soir : le mode « pensées ».
L’image se troubla légèrement. La voix du petit homme retentit de nouveau. Bien que couverte par la traduction simultanée, on la devinait étrange, comme floue – parce que ce n’était pas une voix exprimée physiquement.
— Un triumvirat… quels imbéciles.
Il y eut un tonnerre d’applaudissements.
— Je paierais cher, continua la pensée, pour voir leur tête quand eux aussi seront éliminés. J’aurais dû demander une vidéo…
L’homme s’arrêta brutalement, fixa un point au loin, puis focalisa directement sur ce qui aurait été la caméra si caméra il y avait eu. Mais il n’y avait rien. Il secoua la tête, vérifia encore une fois, se retourna et partit.
— Ce que vous venez de voir, repris le maitre de cérémonie devant l’image de la salle vide, est le seul – et je dis bien le seul inconvénient de notre technologie. Les sujets ne savent pas, et ne peuvent pas savoir qu’ils sont espionnés. Mais, parfois, ils expérimentent une vague impression que quelqu’un les regarde par la fenêtre.
05 - L’ange déchu
Note publique de service
en date du 26 tishri 5779 / 5 octobre 2018 / 24 muharram 1440
émise par l’Archange Michel du Jugement Dernier, président du Service Juridique Suprême du Paradis
à destination de tous les Archanges, Anges, Angelots, Saints, Bienheureux et autres habitants du Paradis.
Objet : Publication de décision judiciaire
Il est porté à votre connaissance par la présente la décision définitive et irrévocable du Service Juridique Suprême du Paradis, mandaté par notre Seigneur à l’encontre de l’Ange de septième classe Nathanaël, résident habituellement au 37 allée des cirrocumulus, 14230 Paradis secteur 14-23, second étage à gauche.
Il a été porté à notre connaissance, de par une source anonyme, d’un blasphème de premier ordre proféré lors d’une réunion à caractère privé, mais tenu dans un lieu public, en l’espèce le pub nommé « La Fin des Temps », 14 avenue du stratus, 14 230 Paradis secteur 14-23. L’Ange Nathanaël, s’étant vu refusé une septième pinte de bière, se serait alors écrié, selon les témoins : « De toute façon, ces histoires de religion, c’est que des conneries ! », puis aurait ajouté, à l’attention du barman, « Et puis Saint Patrick c’est qu’un connard, et en plus il n’existe même pas ! ». Il fut porté précision à la cour que ledit barman était d’ascendance irlandaise, ce qui constituait en l’espèce une insulte en plus du blasphème.
Convoqué pour se défendre devant la cour de la 4ème Chambre Judiciaire Paradisiaque le 28 eloul 5778 / 8 septembre 2018 / 27 dhu al-hijjah 1439, l’Ange Nathanaël a tenté de nier en bloc. Confondu par les images de vidéoprotection du pub, il a ensuite tout avoué et tenté d’invoquer les excuses de la fatigue et de l’alcool. Puis, jugeant que la réaction de la cour lui semblait défavorable, il a tenté de détendre l’atmosphère proférant une blague qui commençait par « Alors c’est un rabbin, un prêtre et un imam qui rentrent dans un bar… ». La réactivité du président de la cour lui a interdit d’aller plus loin.
Enfin en possession de toutes les informations nécessaires, la cour s’est retirée et a délibéré, pour rendre le jugement qui suit :
L’Ange de septième classe Nathanaël, résident habituellement au 37 allée des cirrocumulus, 14 230 Paradis secteur 14-23, second étage à gauche, se voit condamné à une peine de déchéance par humanité et de privation de ses droits angéliques pour une durée de mille-trois-cent-cinquante (1350) jours, répartis comme suit :
- Mille (1000) jours pour blasphème de premier ordre ;
- Cent (100) jours pour insulte à caractère discriminatoire proférée directement à la face d’une minorité visible ;
- Deux-cent-cinquante (250) pour tentative d’humour éculé devant un tribunal paradisiaque.
Le jugement étant non susceptible d’appel ou de grâce de par la nature omnisciente, omnipotente et infaillible des juges, il est immédiatement exécutoire. L’Ange de septième classe Nathanaël, résident habituellement au 37 allée des cirrocumulus, 14 230 Paradis secteur 14-23, second étage à gauche, est donc convoqué aux Portes du Paradis ce 27 tishri 5779 / 6 octobre 2018 / 25 muharram 1440 où il devra remettre ses attributs angéliques (auréole, ailes, vêtement immaculé et asexuité) en vue de son incarnation.
Il sera admis à réintégrer le Paradis au soir du 18 Sivan 5782 / 17 juin 2022 / 17 dhu al-Qidah 1443, en son exact ancien poste.
Fait au Service Juridique Suprême du Paradis, 7 boulevard Jésus, 01 010 Paradis secteur 01-01, le 26 tishri 5779 / 5 octobre 2018 / 24 muharram 1440,
YHWH / Dieu / Allah, per procurationem Archange Michel
06 - La bataille de deux armées dans un monde dystopique formicapunk
— Bonjour monsieur Smith.
— Bonjour, monsieur Johnson.
— Comme convenu, j’ai lu le projet que vous nous avez soumis avec attention. Si je puis le résumer, il s’agit d’un film de guerre, qui narrerait la plus grande bataille de tous les temps entre les deux armées géantes de deux superpuissances.
— C’est juste, monsieur Johnson.
— Il s’agirait donc d’un film de guerre tout à fait classique.
— Je me permets de préciser que c’est une vision réductrice du projet, monsieur Johnson.
— En effet. Votre ébauche se passe dans le futur, c’est une anticipation.
— Une dystopie, pour être exact, monsieur Johnson. L’URSS aurait survécu et serait toujours une dictature. L’Amérique – que Dieu la bénisse – serait elle aussi despotique. J’ai imaginé que ce serait là une expression à tendance nihiliste de la perception qu’ont nos habitants du monde actuel, chacun via son propre prisme, et que cela rassemblerait les spectateurs autour de notre film en leur montrant une catharsis
— Je pense avoir saisi, monsieur Smith. Et donc vous désireriez donner à cette dictature américaine des traits nazifomes ?
— Il faut que le spectateur moyen comprenne immédiatement ce dont il s’agit, monsieur Johnson.
— Je vois. Votre projet indiquait aussi que votre univers est… je retrouve le terme, « formicapunk ». Je ne suis pas certain d’avoir bien appréhendé ce dont il s’agissait. Pouvez-vous m’apporter quelques précisions ?
— Le formicapunk, monsieur Johnson, c’est tout simplement le même concept que le steampunk, sauf qu’au lieu que la technologie se soit arrêtée à l’époque victorienne, elle a stoppé aux années 1970-1980.
— Je comprends. Mais alors, quelle est la différence avec le cyberpunk des origines ?
— Je… l’époque et l’anticipation, en réalité, monsieur Johnson. Le cyberpunk alertait sur ce qui pourrait se passer si la technologie de cette génération continuait dans une mauvaise direction. Nous savons comment la technologie a effectivement évolué, mais je propose une lecture rétrofuturiste de la chose.
— Vous comptez donc conserver le côté « punk » du cyberpunk, à l’inverse de l’immense majorité des productions steampunk ?
— Dans ma vision d’origine, oui, monsieur Johnson. Cela permettrait un retour aux sources attendu par bien des spectateurs, se marierait à la perfection avec le thème de la dystopie, trouve sa place dans un film de guerre et bien entendu autoriserait une lecture mature de l’œuvre finale.
— Je comprends votre position. Je suppose que vous avez songé à la manière d’intégrer nos sponsors dans cette vision, ainsi que les contraintes qui régissent le classement PG-13.
— Heu… j’imagine que tout ceci nécessitera quelques adaptations mineures, monsieur Johnson.
— Mais en réalité, en quoi tout ceci est-il différent, dans le résultat, des créations d’anticipation des années 1970-1980 ? Tout était déjà là, non ? Le côté dystopique était souvent présent à cause du contexte de la guerre froide, et le « formicapunk » comme vous l’appelez n’est guère dissemblable de la vision du futur que l’on avait à l’époque.
— Mais…
— Je sais que le rétrofuturisme est à la mode, monsieur Smith, mais je vous conseille de revenir nous voir lorsque vous aurez un projet mieux ficelé et compatible avec nos contraintes de production.
— Je…
— Au revoir, monsieur Smith.
— Au revoir, monsieur Johnson.
07 - Musique toxique
Ting ! Encore un message d’un ami qui mentionnait cet album – Impressions d’Ensemble, des Anges Plumés, un groupe tout à fait inconnu jusqu’ici. Las, dubitatif et curieux, Yogan s’affala sur son canapé, et d’un tapotement sur l’écran de son smartphone, lança la lecture. Le minuscule hautparleur crachota les premières notes. Du piano, et… un instrument synthétique qu’il n’identifiait pas ?
Cet album était brutalement devenu un phénomène de société : en quelques semaines seulement, il prenait le chemin de la meilleure vente française de tous les temps, une prouesse d’autant plus remarquable qu’il n’avait fait l’objet d’aucune publicité. Les achats à l’étranger suivaient le même chemin.
— C’est pas mal, se dit Yogan, mais ça mériterait d’être écouté au calme sur du vrai matériel.
Il se leva, et regarda par la fenêtre. Au loin à l’ouest, le soleil se couchait – déjà ? Le jeune homme consulta l’heure. Il avait écouté tout l’album d’une traite, sans même s’en rendre compte ! À ses yeux les triomphes populaires étaient de la merde consensuelle qui ne rassemblait que grâce à un matraquage général ; mais là il tenait un véritable succès mérité (selon ses propres critères).
Mais, il y avait quelque chose qu’il ne comprenait pas. Yogan était musicien, et se piquait de savoir analyser une chanson. Pourquoi celle-ci fonctionnait-elle si bien ? Rien d’aussi évident qu’un refrain entêtant ; les compositions étaient même d’une complexité surprenante pour des titres avec une telle résonance chez le grand public. Le jeune homme engloutit un couscous industriel fadasse réchauffé au microonde, acheta le disque en haute qualité sur Internet et le lança sur les enceintes de son ordinateur.
Cinq minutes plus tard, vautré dans son fauteuil, dans le silence de l’appartement, il fixait son écran. Non, soixante-cinq minutes plus tard. Il avait de nouveau écouté l’album dans son entièreté sans même s’en rendre compte. Par quel prodige était-ce possible ? Il se fit un café, s’assit confortablement, et redémarra la musique, bien décidé à en analyser les subtilités.
Il échoua, encore, et encore, quand soudain l’alarme sonna six heures trente du matin, l’heure de se réveiller et d’aller travailler. Mais il n’avait pas dormi.
— Yogan ! Si c’est pour rêvasser, pose un congé et rentre chez toi !
— Pardon, chef !
— C’est un ordre, Yogan. C’est la troisième fois que je te reprends, c’est la troisième de trop ! Estime-toi heureux que je ne t’inflige pas un blâme !
La troisième fois ? Mais il s’était installé à son bureau il y a moins d’une demi-heure ; d’accord il était fatigué, mais… mais l’horloge de son ordinateur lui indiquait qu’en réalité il était présent depuis plus de deux heures. Avait-il dormi sans s’en rendre compte ? Non. Impossible. Au fond de lui il savait ce qu’il avait fait tout ce temps. Il s’était passé mentalement l’album Impressions d’Ensemble, en boucle, et là encore sans s’en souvenir. Son chef avait raison, il ne pouvait pas travailler dans ces conditions. Il prendrait donc une journée de congé et commencerait par rattraper sa nuit de sommeil manquante.
— Yogan ? Qu’est-ce que tu fous là ? Et baisse le volume !
— Hein ? Je…
Le jeune homme regarda autour de lui. Il était au studio d’enregistrement. Il avait squatté le bureau de l’ingénieur son, libre à cette heure-là, et avait passé l’album des Anges Plumés sur le meilleur matériel disponible, de plus en plus fort. Il n’avait pas dormi. En y repensant, il était même venu directement ici en sortant du travail. Les valises sous ses yeux trahissaient son état de fatigue. Mais il n’était toujours pas fichu de comprendre ce qui provoquait le succès de cette musique. En y réfléchissant, il était incapable de se souvenir de la mélodie. Pas exactement : il pouvait se la rejouer intégralement dans sa tête, mais comme si c’était une piste unique, indépendante de sa volonté. Yogan savait qu’il démarrait l’écoute, il savait qu’il avait atteint la fin (c’était facile, c’est quand tout s’arrêtait), mais au milieu… rien.
Alors il recommençait.
— Tu es sûr que ça va, Yogan ?
— T’inquiètes. Tu connais ça ?
Il relança l’album au début. Les deux hommes l’écoutèrent, essayèrent de comprendre. Impossible.
* * *
Lorsqu’on les retrouva, c’est une ambulance que l’on dut envoyer, les deux jeunes gens ayant oublié de dormir, de s’alimenter, même de boire. Les infirmiers ne se méfièrent pas, et leur accordèrent de conserver une enceinte portable dans le véhicule. Il eut fallu leur enlever de force et leur administrer un puissant sédatif pour parvenir à un autre résultat.
Arrivés à l’hôpital, c’est trois personnes de plus qui écoutaient cet album en boucle. Les arrivées causées pas cette musique se multiplièrent. Les autorités tentèrent de la faire interdire, mais c’était beaucoup trop tard : toutes les radios la diffusaient dès que possible, quelle que soit leur programmation habituelle ; les sites de streaming la mettaient en avant par tous les moyens à leur disposition.
Et bientôt il n’y eut plus qu’une seule musique au monde, une mélodie entêtante, envoutante, dont personne ne parvenait à se souvenir vraiment, mais dont chacun se disait : je vais la réécouter.
08 - Chants magnétiques dans une église en bois
Thorbjørn arriva au sommet d’une crête, et ne reconnut pas le paysage. Son doute mua en certitude : il s’était perdu. La neige modelait la forêt, transformant le terrain au gré des chutes et des fontes. En cette saison, à des latitudes aussi septentrionales, le soleil voguait de « proche de l’horizon » à « pas très haut dans le ciel », et les jours rallongeaient tellement par jour que l’horloge biologique de l’adolescent ne lui était d’aucune aide. Il espérait retrouver un point de repère, mais rien ne ressemble plus à un sapin qu’un autre sapin, à une crête escarpée qu’une autre crête escarpée. Naturellement, il avait commencé par revenir sur ses traces ; mais la petite bise, en plus de transpercer ses fourrures de poignards glacials, avait effacé sa piste.
D’abord, Thorbjørn avait longé ce qu’il était certain d’être le chemin, puis ce qu’il pensait être le chemin, ensuite ce qu’il imaginait avoir été le chemin, et enfin avait essayé de rejoindre un chemin. Debout sur cette crête, à détailler le paysage, il acquit deux convictions. La première, que le jour allait bientôt tomber, et donc qu’il devait trouver un abri. La seconde, qu’il était perdu de la pire des manières. Rien dans les montagnes enneigées et les vallons calmes ne lui rappelait quoi que ce soit ; aucune trace humaine d’aucune sorte ne lui fournissait de repères.
— Les skis, lui avait dit son grand-père de sa voix de baryton, sont ton meilleur ami et ton pire ennemi pour la chasse. Ton meilleur ami, car ils te permettent de pister le gibier sur de grandes distances, sans fatigue. Ton pire ennemi, car ils t’autorisent à te perdre avec célérité.
Il aurait voulu que son aïeul ait tort, mais son verbe s’avérait exact, comme de coutume.
Thorbjørn dégaina alors sa boussole, avec une curieuse impression de tricher comme à chaque fois qu’il se servait de cet instrument. Son grand-père lui avait appris l’usage de l’outil, tout en le mettant en garde : si loin au nord, dans ces montagnes chargées de minerais de fer, l’objet se révélait d’une précision toute relative. Mais au moins lui indiquerait-elle une vague direction ?
L’adolescent navigua une demi-heure à flanc de colline, guidé par l’aiguille rouge et noire, quand il vit le soleil rougeoyer près d’un pic, au loin. Il consulta sa boussole, regarda l’astre du jour, vérifia l’instrument de nouveau. Où se couchait le soleil à cette date ? Encore au sud-ouest, à l’ouest, ou déjà au nord-ouest ? Aucune importance, toute possibilité crédible était en désaccord avec la direction qu’il pensait suivre. Il parcourut l’horizon, lorsqu’il aperçut une construction sombre et pointue, au creux d’un repli de terrain. Un abri ! Il savait où il passerait la nuit, même s’il n’y avait personne là-bas !
Thorbjørn pila dans une grande gerbe de neige. Il arrivait dans une clairière, presque entièrement occupée par un cercle d’herbe verte. Au centre de cette prairie, une petite église en bois dressait ses toits pentus vers le ciel, aussi haut que les sapins alentour. À côté, un élan broutait paisiblement. Comment n’avait-il pas vu cette construction sombre et cette tache de pelouse de très loin ? Aucune importance, il avait un abri pour la nuit, et comme le crépuscule rosissait les montagnes, il n’allait pas faire la fine bouche.
L’adolescent s’approcha de la bâtisse. Malgré une apparence sobre observée à distance, elle s’avérait richement décorée, de ces motifs hérités de l’âge viking. Était-ce réellement une église catholique, ou servait-elle de prétexte pour continuer à adorer les dieux anciens tout en calmant les prêtres du coin ?
Thorbjørn poussa la porte. La boussole vibra avec frénésie dans sa poche. Il fallut quelques minutes au jeune homme pour s’habituer à l’obscurité. Quand il y vit enfin, il découvrit une salle peinte de thèmes qui n’évoquaient définitivement pas la chrétienté. Partout, entre les poutres, des lames de fer de différentes longueurs sifflaient en un murmure imperceptible, activé par les quelques courants d’air. Au fond, deux grands chats touffus gris ardoise jouaient ensemble. Mais le plus bizarre était le sol ; entièrement métallique, il semblait avoir été fondu d’une seule pièce par quelque géant ou par un cataclysme inconcevable. De l’intérieur, l’église donnait l’impression de n’exister que pour protéger cette étrangeté. C’était elle qui affolait la boussole, c’était à cause d’elle – ou grâce à elle ? – que l’adolescent avait trouvé cet abri.
Le sol de fer (ou quoi que ce fut) était dur et glacial, aussi Thorbjørn se réfugia-t-il dans la galerie qui ceinturait la bâtisse. Là, il dévora ses maigres provisions, sans toutefois résister à l’envie de jeter un petit morceau de viande aux chats. Ils chassèrent la miette à travers toute la pièce avant de se décider à la manger.
Puis, épuisé par la course dans le froid et les émotions, il s’endormit.
* * *
On chantait dans l’église, un chœur éthéré, inarticulé, divin. Qui ? L’adolescent ouvrit les yeux. L’odeur de résineux secs et de rouille restait identique ; mais les petites fenêtres rayonnaient de lueurs pulsées et vibrionnantes vertes aux éclats roses. Sur le sol métallique se tenait une forme humaine. Une femme ? Difficile à déterminer dans cette luminosité changeante. Les félins gambadaient autour. Freyja ? Freyja !
Mais à la seconde où il eut la certitude d’avoir reconnu l’antique déesse, il ne vit plus que des jeux de lumière dans la poussière ; et les chœurs invisibles reprirent leurs mélodies de plus belle. Où étaient les chanteurs ? Était-ce des dieux ? Thorbjørn se rua à l’extérieur, s’il y avait une magie à l’œuvre, il devait la voir, la comprendre, témoigner ensuite. Peut-être qu’on ne le croirait pas, mais lui saurait.
Dehors dans la pâle nuit qui précède l’aube, d’immenses draperies de feu vert et rose incendiaient les montagnes alentour de leurs flammes cyclopéennes. Comme un orgue divin, l’église tout entière chantait et vibrait au rythme des ondulations titanesques, concert de géants pour l’adolescent. Assis par terre sur le parvis, il écoutait et admirait, pleurant de joie.
* * *
— Debout, petit. Il faut partir, maintenant.
Thorbjørn se réveilla, brisé par les courbattures. Il reconnaitrait cette grave et éraillée voix entre toutes, c’était celle de son grand-père. Il essaya de se lever, et se cogna la tête. Un instant d’observation lui apprit qu’il avait dormi pelotonné dans le trou d’un immense sapin. À l’extérieur, l’ancêtre, assis sur un tronc, lui servait depuis un thermos une tasse de café chaud à l’odeur réconfortante.
Aucune trace d’aucune église, aucune étendue d’herbe dégagée en vue. De longs poils soyeux couleur ardoise restaient accrochés à sa besace. Était-ce un rêve ? Il narra l’aventure à son aïeul, il savait que lui ne se moquerait pas.
— Une église en bois debout ? Étrange, petit, il n’y a pas de stavkirke dans cette région. Mais…
— Mais ?
— Mais nos amis de l’Est, qui sont des gens sages, racontent la légende que voici. Ils prétendent que lorsque le renard polaire gambade dans les vastes étendues enneigées, lorsque sa queue immaculée balaye les flocons jusqu’au ciel, l’homme prudent ne doit pas rester dehors, car la nuit appartient aux Dieux. Cependant, l’homme courageux à l’âme pure peut assister aux concerts divins.
— Et alors ?
— Alors, petit, j’ai écouté les chants magnétiques et je t’ai retrouvé. Tu as fini ton café ? Rentrons, maintenant, tes parents vont s’inquiéter.

Le chat est CC-BY 2.0 Pieter Lanser.
09 – Un dieu de savon
Ce samedi-là, Asako avait invité Emma chez ses parents. Un rendez-vous inhabituel : l’ordinaire voulait que les deux gamines se retrouvent chez Emma, qui vivait dans un appartement plus grand et moins culturel – selon le vocabulaire de la jeune Japonaise.
Aussi, à l’heure dite, l’adolescente rousse était assise sur la haute marche de l’entrée genkan, à ranger ses chaussures dans un casier. Son amie l’accueillait, vêtue d’un yukata bariolé. Était-ce la tenue qu’elle portait couramment chez elle, ou une fantaisie qui lui avait pris à l’occasion de l’arrivée d’Emma ? Elle n’obtint pas de réponse à cette question muette, car la Japonaise la tira dans sa chambre.
La pièce, à l’image de la maison, était petite, encombrée et… Asako avait raison, le mot « culturel » était le plus approprié. Rentrer dans cet appartement, c’était comme voyager au Japon, avec à peine plus de textes compréhensibles et un décor moins exotique par-delà les fenêtres. Emma se retint de regarder un peu partout – il y avait quelque chose de mignon dans la façon dont tout était agencé pour optimiser le moindre espace. Les deux jeunes filles discutèrent de tout et de rien devant un jeu vidéo.
Asako perdit encore une manche. Bizarre, normalement c’était elle la meilleure en plateforme, Emma laminait sa complice aux jeux de stratégie. La rouquine observa son amie. Elle était tendue, ce qui ne lui ressemblait pas. Même son éternel chignon à baguettes était monté de travers.
— Asa… avoue, tu ne m’as pas fait venir juste pour me montrer l’appart de tes parents. J’ai bon ?
Un sourire triste se dessina sur le visage de la Japonaise.
— Toi, on ne peut rien te cacher, comme d’habitude. Mais je préfère t’en parler plus tard. Tiens, tu connais ça ? C’est excellent, ça devrait te plaire !
Emma regarda le tome que son amie lui avait posé entre les mains – grossière manœuvre pour changer de sujet, mais la jeune fille avait compris le message.
— Asa, c’est gentil, mais… je ne lis pas le japonais.
— Les gamines, le gouter est servi !
Ça, c’était le grand frère d’Asako. La rousse se retint de justesse de lui donner du « Je ne suis plus une enfant, mais une préadolescente ! » qu’elle débitait à ses parents en ces circonstances.
— Je vais me laver les mains, cria-t-elle en retour et en se levant.
— Emma, attends !…
Trop tard. La jeune fille se tenait déjà debout dans la porte ouverte de la salle de bains, interloquée – au moins elle changé de chaussons, pensa Asako dans un étrange souci du détail.
— Heu, Asa ? C’est quoi, ça ?
Le « ça » désignait un savon tout ce qu’il y avait de plus ordinaire, posé dans un porte-savon parfaitement standard, entouré de petites cordelettes tressées d’où pendaient des bandelettes de papier blanc plié.
— Emma, je te présente Sekken-sama. Sekken-sama, voici mon amie Emma.
Le regard de la jeune rousse alterna entre sa complice et le porte-savon. L’attitude entière de la Japonaise criait au monde qu’elle voulait se rendre invisible. Et assis entre les ficelles, il y eut un minuscule personnage à l’étrange tête carrée, jaunâtre, à l’aspect doux, comme s’il était lui-même constitué de savon.
— Asa, demanda Emma en désignant l’être du doigt, je ne suis pas folle ? Il y a un… truc là, qui me regarde (qui la saluait à la mode japonaise, en réalité). Je ne rêve pas ?
— Non, tu ne rêves pas, mais la plupart des visiteurs ne le voient pas. C’est Sekken-sama. C’est… tu dirais que c’est un esprit, ou une espèce de dieu. On appelle ça un kami.
— Vous avez un dieu chez vous ? Mais c’est génial !
L’adolescente s’approcha de l’installation, elle avait le nez presque contre les cordelettes maintenant.
— Bonjour, monsieur le dieu !, claironna-t-elle dans un grand sourire charmeur. Mon nom est Emma, je suis enchantée de vous rencontrer, monsieur… (elle se retourna) comment tu as dit qu’il s’appelait, déjà ?
— Sekken-sama, répondit le grand frère qui était arrivé entre temps. Personnellement je préfère Yog-Sothoth, mais si tout ça c’est trop compliqué pour toi, tu peux l’appeler Bubulles.
Un trait de mousse jaillit de la main du kami jusque dans la bouche de l’importun.
— Ne. M’appelle. Pas. Bubulles !, dit-il d’une voix savonneuse.
Asako tira son amie par la manche.
— Mon idiot de frère n’a plus le respect des dieux. Maintenant ils vont se disputer pendant une demi-heure, et le crétin va perdre, comme d’hab. Viens, tu te laveras les mains dans la cuisine.
Dix minutes plus tard, elles dégustaient des mochis avec du thé – Emma n’avait jamais apprécié le gout astringent du thé vert, mais par respect pour la personne qui l’avait préparé, elle se forçait à finir sa tasse.
— Je suis tellement désolée que tu aies vu cette scène ridicule, s’excusa Asako. J’aurais dû te prévenir.
— Arrête, c’est génial. Tu as un dieu chez toi. Tu imagines la chance que c’est ?
— Tout le monde en a, mais personne n’y fait plus attention. Va savoir, tu héberges peut-être un dieu du papier toilette ?
— Quoi ? Beurk, non ! N’importe quoi ! Mais au fait, tu voulais me dire quelque chose ?
— Oui. Tu sais, mon père a des grosses responsabilités. C’est grâce à lui qu’on vit ici. Mais à cause de son boulot, on va tous retourner au Japon cet été. Mais, enchaina Asako avant qu’Emma ne puisse réagir, on restera amies, il y a Internet et tout, et puis je reviendrai, si on ne peut pas revenir avec le travail de papa je reviendrai pour mes études !
Emma demeura plantée là, quelques instants, à regarder dans le vague. Elle digérait la nouvelle. Comment allait-elle prendre cette révélation ? Asa mordillait sa lèvre inférieure, dans l’attente d’une réponse.
— Dis-moi… vous allez déménager le dieu ? Tu crois que je pourrais le garder ?
La Japonaise éclata d’un grand rire, d’abord nerveux puis franc. Emma restait Emma et ne changerait jamais. Bien sûr que leur amitié résisterait à la distance !
Retrouvez Emma dans « Ce qui est dans le noir », qui se passe trois ans avant la présente histoire ; et les deux gamines dix ans plus tard dans « Derrière la deuxième porte du placard à balais ».
10 – Ce que les extraterrestres gris font aux vaches
À Fredric Brown, qui a prouvé très tôt que l’on pouvait rire des extraterrestres tout comme il était possible d’écrire d’excellentes nouvelles sur une seule page.
La nuit de fin de printemps étendait son calme tiède sur campagne normande. Loin, haut dans le ciel, un point lumineux tournoyait en une danse d’apparence aléatoire. Lorsqu’il eut trouvé ce qu’il cherchait, il chut et s’avéra être une soucoupe volante – deux disques de métal bombés collés l’un sur l’autre, avec de petits hublots dans la partie supérieure. Elle flotta quelques instants au-dessus d’un champ à vaches dans un sifflement obsédant, le temps que trois pattes d’acier se déplièrent. Les animaux admirèrent le spectacle d’un air bovin, puis reprirent leurs mâchouillements. Une longue rampe phosphorescente se déploya du vaisseau vers le sol ; au bout d’icelle, une ouverture lumineuse laissa apparaitre deux extraterrestres.
Voyez-vous, il existe beaucoup d’êtres vivants dans l’univers, et nombre d’entre eux sont humanoïdes, intelligents, voire les deux à la fois. Si certains dépassent de beaucoup l’imagination d’auteurs de science-fiction bourrés de drogues, ceux qui atterrirent dans la cambrousse ce soir-là n’étaient pas originaux : c’étaient des Petits-Gris tout ce qu’il y a de plus clichés. Leur origine de la face cachée de la Lune et leurs fréquentes visites sur Terre sont probablement à l’origine de leur reconnaissance par le public.
Les deux extraterrestres, donc, déambulèrent dans le troupeau, analysant les bovidés à l’aide de petits appareils portatifs. Ils sélectionnèrent trois animaux, qu’ils firent se lever et dirigèrent vers le vaisseau.
À trois-cents mètres de là, dans l’antique bâtisse, le fermier ne dormait pas. Il avait entendu le manège de la soucoupe, avait saisi son fusil et fouillait maintenant dans la caisse à munitions pour trouver les cartouches adaptées (le gros sel pour la branche honnie de la famille, les balles en argent pour les loups-garous, les gousses d’ail pour les vampires, les minishurikens pour les ninjas – on n’avait jamais aperçu de ninjas dans la région, mais on n’était jamais trop prudent, et c’était le propre des ninjas de ne pas être vus – ah ! la chevrotine alu pour les aliens, c’était parti !).
C’est donc un vieux paysan et en pyjama, la moustache hérissée de colère, qui fonça vers le vaisseau, fusil chargé, prêt à en découdre avec ces extraterrestres qui volaient son bétail. Loin de s’affoler devant cette vision d’horreur, l’un des étrangers dégaina une arme bizarre, et d’un rayon violet paralysa le pauvre homme.
— Tu as la procédure « humains » sous la main ? demanda celui qui aurait semblé plus jeune pour quelqu’un capable de différencier ces deux êtres.
(Le fermier, quoiqu’immobilisé, restait parfaitement conscient ; pour lui, le dialecte des extraterrestres n’était qu’une série de sifflements et grognements désarticulés et inquiétants).
— Attends, je regarde ça… (d’un doigt gris sans ongle, il feuilleta un petit carnet). Alors, si j’en crois le règlement, on doit lui insérer une sonde anale, puis l’endormir, puis le déposer près de chez lui.
— Dans cet ordre ?
— Curieusement, oui.
— Bon, je vais préparer le matériel. Quelles analyses sont demandées ?
— Aucune. Apparemment, on doit introduire l’instrument, lancer le programme en mode autotest pour afficher plein de lumières, et récupérer l’équipement.
— … je suppose que de grands exoethnologues ont imaginé cette procédure. C’est parti, on a pas que ça à faire.
D’un rayon vert, le petit-gris fit léviter le paysan et l’emmena dans le vaisseau, où il lui subit le traitement règlementaire. Pendant ce temps, l’autre s’en fut emprunter un tabouret et un seau à l’exploitation.
Une demi-heure plus tard, les trois vaches broutaient de nouveau l’herbe grasse, le fermier dormait affalé devant sa porte, et la soucoupe décollait dans un sifflement obsédant. Arrivée à cent mètres du sol, elle alluma trois projecteurs puissants et parcourut un circuit complexe au-dessus de la petite ville voisine. Pourquoi ? Mystère, mais là encore la procédure l’exigeait.
Pendant la manœuvre, le jeune petit-gris réfléchissait.
— Toutes ces procédures, c’est bien compliqué pour pas grand-chose, non ? Je sais bien que c’est étudié, mais bon…
— Bah, on s’amuse bien et on est bien payés, c’est tout ce qui compte.
— Ouais, mais c’est une utilisation bizarre de l’argent public…
— Merde ! Avec tout ça, j’ai complètement oublié de tracer les motifs dans le blé !
— Franchement ? On s’en fout non ? Qui ira vérifier ?
— Hmm… sur ce coup-là, tu n’as pas tort. Surtout que maintenant les humains en dessinent plein eux-mêmes.
— Mais quand on y réfléchit bien… quatre-cent-mille kilomètres et toutes ces salades pour un peu de lait… notre Reine-Mère a parfois des demandes étranges.
11 – Insomnie au fond de la rivière
Le jeune garçon se saisit de la lanterne, un modèle en papier suspendu à une branche, et s’avança seul dans la nuit. L’obscurité était totale en cette nuit sans lune. Un voile nuageux effaçait les étoiles et les villageois, dans l’attente d’un résultat à la Cérémonie s’étaient terrés chez eux, volets clos et chandelles éteintes.
Après quelques minutes de marches, le garçon sentit qu’il était arrivé au bon endroit. Pourquoi ici et pas ailleurs ? Seul son instinct aurait pu répondre à cette question, mais il en était certain, c’était à cet endroit. Il planta sa lanterne, s’allongea dans une herbe sèche qui n’aurait jamais dû être là, et les yeux levés vers les astres invisibles, étendit les bras. Sa main gauche atteint un petit ruisseau d’eau tiède, unique reste de la puissante rivière qui aurait dû dévaler cette vallée, emplissant le lit au fond duquel il était couché.
Le jeune garçon se répéta en marmonnant les différentes étapes de la cérémonie qu’il devait respecter. Trouver l’endroit, ça, c’était fait. Mettre la lanterne en place. S’allonger la tête vers l’amont, et toucher l’onde. Ensuite… ah, attendre que la lumière s’éteigne, ce qui devrait être rapide. Puis avaler la préparation-aux-esprits, et s’endormir pour rentrer en contact avec eux. Et enfin, demander aux esprits de faire revenir la pluie et la rivière.
Alors, couché aussi confortablement que possible, il patienta – il n’avait que ça à faire. Le temps était doux, un vent humide s’élevait des plaines. Pour la première fois depuis des mois il avait amené de vrais nuages, mais toujours pas la moindre goutte de bruine à l’horizon, ce qui avait poussé les Anciens à procéder à la Cérémonie.
Le jeune garçon était plutôt fier d’avoir été choisi pour une mission aussi importante que la Cérémonie. Les préparatifs avaient duré un jour et une nuit ; il avait répété les gestes des dizaines de fois, appris par cœur les formules de politesse et les doléances à présenter aux esprits. Il se sentait prêt, digne, et impatient d’accomplir son rôle.
La faible lumière jaune émise par la lanterne oscilla, devint franchement rouge et disparue définitivement dans un filet de fumée. Le jeune garçon déplia alors la feuille de vigne que l’on avait accrochée à sa ceinture, et en emboucha le contenu. C’était une pâte à la texture caoutchouteuse et fondante, avec un gout prononcé de menthe, de thym, d’avoine et de champignon.
— Il faut bien mâcher et tout avaler, même si ce n’est pas bon », lui avait dit le chamane. Je ne peux pas te faire gouter, cette préparation ne sert et ne doit servir qu’à communiquer avec les esprits.
Alors il mâcha encore et encore, et avala. Et maintenant ? Il ne lui restait plus qu’à s’assoupir.
C’était plus facile à dire qu’à faire. Pourquoi est-ce toujours lorsque l’on veut trouver le sommeil qu’il nous fuit ?
Ses pensées vagabondèrent, et remontèrent le fil du temps. Il s’était préparé à cette mission. Il allait la réussi, même s’il devait s’endormir de force – peut-on s’endormir de force ? Il avait été choisi à cette responsabilité, tout le village comptait sur lui, il ne pouvait pas échouer simplement parce qu’il n’arrivait pas à s’endormir ! C’était impossible !
Le vent s’intensifia et fraichissait ; sous les maigres touffes d’herbe sèche, la pierre du lit de la rivière se faisait de moins en moins confortable. Mais il devait rester là et s’assoupir, c’était de son devoir. Il s’était même proposé pour ça. Il était… presque certain d’avoir été volontaire. Après une longue discussion avec les Anciens, en fait. Mais il avait été heureux d’accepter, de se rendre utile à la communauté qui le nourrissait. En tant qu’enfant du village (il n’avait aucun souvenir de ses parents), il devait bien ce service à la collectivité.
Ses amis avaient réagi en… alors qu’il y réfléchissait, il n’avait pas la moindre idée de comment ses proches avaient pu réagir. Entre le moment où il avait été élu pour présider à la Cérémonie et maintenant, il n’avait rencontré que le chamane et les Anciens. Mais il était sûr que tous ses camarades étaient jaloux et allaient le presser de questions quand il rentrerait, la rivière gonflée d’eau fraiche derrière lui.
La température chut encore, l’air se fit moite. Le jeune garçon avait froid, mais rien pour se couvrir. Le froid allait-il l’aider à s’endormir ? À moins que ce ne soit le contraire ?
Maintenant qu’il y réfléchissait, les visages qu’il avait croisés en remontant fièrement la grand-rue (la seule, en vérité) du village exprimaient plus la peur et le chagrin que la joie d’avoir de nouveau de l’eau à foison ou l’envie. Pourquoi ? Mais le chamane et les anciens étaient sages, ils devaient savoir ce qu’ils faisaient. Le froid commençait à l’engourdir, est-ce que ça aurait une conséquence dans le monde des esprits ?
Une pâle lueur bleue s’éleva de l’onde à sa gauche, et s’approcha de lui. Un esprit ? Probablement, maintenant qu’il en voyait les détails, c’était comme un petit être humain fait d’eau. Il s’assit, et la chose lui tournoya autour.
Le jeune garçon se concentra, et lui dit les mots qu’il avait appris avec soin. L’esprit, car c’en était bien un, lui répondit directement dans sa tête :
— Moi, esprit gardien de cette rivière, exaucerai ton souhait très bientôt. Regarde au-dessus de toi, puis suis-moi.
Le jeune s’aperçut alors qu’il y voyait maintenant presque comme en plein jour, bien qu’il fit encore nuit noire. L’être lui désignait les nuages, épais et lourds, qui s’accumulaient contre les pics proches. Le garçon suivit la rivière, et quelques instants plus tard, plic ! ploc ! de grosses gouttes de pluie s’écrasaient au fond du lit asséché.
Et, quelques heures après, les averses tant attendues avaient rendu au cours d’eau son apparence normale.
12 – Un brave blaireau
Erik était mort. Il n’avait aucun doute sur ce fait : devant lui, un gigantesque panneau déclarait « Bienvenue après la mort ! », et en plus-petit, en dessous, « N’ayez pas peur, nous nous occupons de tout ». Tout ceci surplombait un immense comptoir de bois blanc, large à perte de vue, derrière lequel patientaient des êtres lumineux. Intrigué, Erik s’approcha de l’un d’eux.
— Bonjour. Vous êtes bien Erik E. ?
— Heu… oui ?
— Bienvenue, Erik ! Vous êtes mort, mais ce n’est pas grave. Nous allons voir ensemble ce que nous pouvons faire de vous. Pouvez-vous vérifier l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche ?
L’être – un ange ? – lui tendit une feuille de papier sur laquelle était inscrit tout son état civil et les principales actions qu’il avait effectuées de son vivant.
— Tout est conforme, dit enfin Erik.
— Parfait. (L’être introduit la page dans une machine, diverses informations clignotèrent sur un écran). Je vois que vous êtes catholique et musulman, avez-vous une préférence pour votre vie dans l’au-delà ?
— Pardon ? Je ne suis aucun des deux !
— Permettez-moi de vous contredire : vous avez été baptisé, avez fait votre première communion et vous vous êtes confirmé. D’autre part, vous vous êtes converti à l’Islam le dimanche sept novembre deux-mille-quatre, à trois heures quarante-sept du matin heure locale, par la récitation de la formule rituelle en présence d’au moins deux témoins.
— Heu… en deux-mille-quatre j’étais étudiant, peut-être qu’une fête un peu alcoolisée…
— Je note donc, aucune préférence. Vous pouvez continuer avec notre conseiller d’orientation. Veuillez passer la porte, je vous prie.
Une ouverture remplaça l’être lumineux et sa portion de comptoir. Erik la franchit – quel autre choix avait-il ?
Derrière le seuil se trouvait une pièce sobre et fonctionnelle, pourvue d’un bureau en bois sombre et de deux fauteuils : un en métal dur et désagréable sur lequel on lui demanda de s’assoir, et l’autre moelleux et confortable, dans lequel l’attendait son interlocuteur. Ce dernier ne prit pas la peine de se lever pour le saluer. C’était un grand homme au teint rouge, cornu, au sourire sadique, habillé dans un costume chic. Un diable ?
— Assieds-toi, Erik. Tu m’as bien reconnu, et oui, mes pouvoirs me permettent de rencontrer individuellement toute personne qui peut finir en Enfer, et crois-moi, ça représente du monde. Bon, étudions ton cas, veux-tu ?
Il se saisit d’une tablette informatique posée sur le bureau, et fit défiler une longue liste, devant laquelle il gloussait ou émettait de petits bruits approbateurs à intervalles réguliers.
— Parfait ! déclara-t-il enfin. Votre dossier est… tout juste moyen, ni le Paradis ni les Enfers ne sont garantis pour vous. Vous allez donc être soumis à la Question.
— Pardon ?
— Pas d’inquiétude, il ne s’agit pas d’une torture moyenâgeuse. Je vais vous donner une expression, vous me direz ce qu’elle vous inspire. Votre sort dépendra de votre réponse.
— Je suppose que je n’ai pas le choix.
— Non. La locution est : « Un brave blaireau ». C’est à vous.
— C’est tout ? Il va me falloir des précisions. Quel genre de blaireau ? L’animal ? L’outil pour se raser ? Le pinceau ? Le genre de personne qui est un peu neuneu ? Et brave, mais dans quel sens ? Brave-honorifique, qui ne craint pas l’ennemi, ou brave-couillon, gentil, mais bête ?
— Vous avez toute liberté d’interprétation.
— Mais il n’y a rien à interpréter. Ce n’est même pas une phrase, c’est tout juste deux mots qui ne vont pas ensemble. Si « blaireau » fait référence à un objet, ça n’a pas de logique parce que quelque chose d’inanimé ne peut pas être brave – quel que soit le sens qu’on donne à ce mot. Pareil avec l’animal, d’une certaine façon : un mustélidé, c’est toujours sot, et n’a pas de notion de courage au combat, ça raisonne en termes de survie. En fait, c’est une insulte, non ? Un brave blaireau, c’est quelqu’un de gentil, mais très con et un peu prétentieux. Ça fait référence à qui ? Pas à moi j’espère, parce que ça ne correspond pas à ma vie. J’ai sans doute été brave, dans le sens noble du terme, mais je ne suis certainement pas un blaireau, puisque je suis humain et…
— C’est bon, Erik. Vous irez au Paradis. Celui de votre choix.
— Oh ? J’ai réussi le test ?
— Non. Mais je ne veux pas de quelqu’un d’aussi chiant en Enfer.
13 – Et si tu étais le double maléfique ?
Tu arrives à un moment de ta vie où tu te poses des questions sur tes actions, leurs conséquences sur tes proches, tes amis, tes collègues, ta famille. Et voici qu’apparait une nouvelle technologie qui permet de voir à travers les dimensions probabilistes, et de connaitre les décisions prises par ton double.
Car toute personne possède un double – un seul. Ce n’est pas quelqu’un avec qui nous partageons le même monde physique, mais c’est la version de toi ou moi qui a tranché autre chose aux choix cruciaux de nos existences. Ton double, c’est toi – mais ce n’est pas exactement toi. Ses actes dissemblables l’ont rendu subtilement étranger. Et tu peux le connaitre, le voir, remonter sa vie et savoir ce qu’aurait pu être la tienne dans des circonstances différentes.
Te voici devant l’appareil. Une note te rappelle que les êtres vont par deux ; toute personne a son double. L’une des moitiés est bénéfique, a amélioré le bonheur général autour d’elle. L’autre, dans une espèce de balance cosmique constamment à l’équilibre, est maléfique, détruit son entourage, grâce à ses actions ou malgré elles. Accepter de consulter la machine, c’est se tenir prêt à affronter cette réalité. Veux-tu poursuivre ? Oui ? Non ?
Bien sûr, tu continues – comme tout le monde en fait. Tu as réfléchi à tes actes, en as tiré la certitude d’être du bon côté de la balance.
Tu es le double maléfique.
Le résultat est clair, la vérité est là, nue, dure et froide comme le poignard de glace qui s’est planté dans ton cœur. Tu tentes de te raccrocher à un mensonge doux et confortable, mais les explications de l’opérateur l’assassinent lentement. Même si les probabilités d’erreur sont infinitésimales, et si ton âme te dit que la machine s’est trompée, ta raison tout entière te hurle la vérité.
Tu es le double maléfique.
Maintenant, réfléchis. Tu connais l’ignoble réalité, juste, objective, immuable. Et maintenant, que vas-tu faire ? Essayer de t’améliorer, de prendre de meilleurs choix, pour inverser vos rôles ?
Ou en profiter pour faire pire ?
14 – Licornes explosives
— Et c’est comme ça que j’ai découvert les licornes explosives.
Olaf l’Aventurier, debout sur une table dans la pénombre de la taverne, savourait l’effet de sa révélation sur son auditoire. Il dégusta une gorgée de vin chaud, distribua un sourire satisfait à l’assistance, et reprit son histoire.
— Comme vous le savez, si on voyage longtemps vers le sud, on accède à des terres ardentes, où seuls les plus terribles hivers connaissent la neige. Si l’on continue, on découvre des territoires brulants, où la saison froide est comme notre été et l’été plus chaud que la canicule. Le prospecteur courageux pourra aller encore au-delà, mais il ne trouvera qu’un désert torride, où l’air cuit comme celui d’un four.
Il avala une nouvelle gorgée.
— Mais je ne me suis pas arrêté là ! J’ai pris contact avec les gens du désert, dont les techniques ancestrales permettent de survivre dans de tels environnements. Ci fait, j’ai pu traverser ces régions hostiles, et vu de mes propres yeux ce qui qui existe de l’autre côté. Car les immensités de sable et de roche nue ne délimitent pas la fin du Monde, non ! L’homme valeureux qui osera s’y aventurer y découvrira des plaines, d’abord sèches puis de plus plus en plus verdoyantes, peuplées d’arbres inconnus, de nations antiques et d’animaux étranges. Et moi qui suis allé là-bas et en suis revenu, je vais témoigner de ce que j’y ai trouvé !
Olaf attendit quelques instants, ménageant son petit effet sur son auditoire.
— Je vais laisser de côté ce que j’ai déniché chez ces populations, il me faudrait une veillée entière pour ne serait-ce qu’effleurer les merveilles que j’y ai observées – et ça tombe bien, parce que c’est exactement le thème de la soirée de demain. Aujourd’hui, je vais vous parler des animaux.
Il se fit servir un nouveau verre de vin chaud, bienvenu avec les premières neiges de l’hiver.
— Là-bas, dans les grandes étendues herbeuses que l’on appelle « savanes », on trouve les bêtes les plus bizarres de la création. Rien à voir avec nos renards, nos élans, nos chouettes ou nos animaux domestiques, messieurs-dame. Non, dans ce pays, Dame Nature a engendré des espèces toutes plus étranges les unes que les autres, avec une propension au gigantisme impressionnante. On y croise des chats géants qui pourraient manger un homme si le désir leur en prenait. Des quadrupèdes montés sur échasses, à la grâce insolite et au cou si long qu’ils pourraient brouter les joubarbes qui poussent sur le faite de cette auberge. Des animaux cuirassés monumentaux, plus hauts que deux adultes, aux quatre pattes comme des troncs et munis d’une queue-serpent à l’avant, dont ils se servent comme une main.
Des murmures parcoururent l’assemblée, appréciés par l’aventurier encore plus que sa boisson, pourtant excellente.
— Je vous sens dubitatifs, braves dames et gens. C’est pourquoi j’invite tous ceux qui doutent de mon histoire à passer dans mes quartiers, dans la suite ducale de cette auberge, demain dès la première heure. Seulement deux deniers l’entrée ; pour un voyage dans les contrées lointaines, c’est donné !
Il y eut des approbations, quelques interrogations sur le prix. Beaucoup de bruit, c’était autant de rumeurs et donc abondance de clients le lendemain : parfait !
— Mais, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, ce n’est pas le plus inconcevable : dans ces contrées distantes, on trouve encore des licornes !
Des « Oh ! » et des « Ah ! ». Une foule était un auditoire incroyablement agréable, que l’on pouvait surprendre par ce qui avait été annoncé cinq minutes plus tôt.
— Toutefois, ne vous imaginez pas de splendides équidés immaculés comme celles qui ont parcouru nos cieux du temps de nos ancêtres. Non, les licornes de ces régions lointaines sont tout à fait différentes. Plus hautes qu’un homme, lourdes comme trente gaillards, elles sont exceptionnellement agiles sous des airs de bêtes dodues et pataudes. Certes, l’épais cuir gris qui leur sert de vêture n’est pas aussi agréable à regarder que le pelage soyeux de nos licornes locales. Mais songez, cher auditoire, que là-bas il ne s’agit pas d’une espèce disparue : les licornes du sud se promènent en troupeaux entiers !
Exclamations et interrogations. Ce vin chaud était décidément excellent.
— Les peuples de la région, malgré leur compétence et leur ingéniosité, craignent leurs licornes, savez-vous pourquoi ? Parce qu’elles explosent ! Si, madame, je vous vois douter de ma parole, mais je vous jure que c’est l’exacte vérité. Poussez à bout un de ces êtres, et il va allumer sa corne, lorsque celle-ci sera consumée, boum ! Il disparaitra dans une grande déflagration, laissant un cratère fumant derrière lui ! D’ailleurs, certaines tribus ont essayé de les dresser pour s’en servir comme arme…
— C’est des conneries, brailla un petit vieux édenté au fond de la salle.
— Pardon ? Qui a dit ça ?
— C’est moi, gamin. J’affirme que ton histoire de licornes explosives, c’est des crétineries pour te faire mousser. Tout ce que t’as raconté avant, c’est cohérent avec les chroniques des autres aventuriers. Mais des bêtes qui éclatent ? Jamais entendu une imbécilité pareille, et en soixante-quinze hivers, j’en ai vu passer des types comme toi !
Ha, ce petit vieux allait tout faire rater ! Mais Olaf avait encore un atout dans sa manche.
— Avec tout le respect que je vous dois, grand-père, je maintiens ma version, qui est tout à fait authentique. D’ailleurs, lorsque les plus jeunes se seront couchés, rappelez-moi de vous raconter comment j’ai sauvé, au péril de ma vie, une charmante autochtone de l’une de ces terribles explosions, et de ce que j’ai appris d’elle quand elle a tenu à me remercier – si vous voyez ce que je veux dire…
Les gloussements scabreux qui remontèrent de l’assistance indiquèrent à l’aventurier qu’il avait récupéré l’attention de son public. La journée du lendemain s’annonçait rentable.
15 – Par-delà la fine membrane de la réalité
Ce jour-là, je cherchais un cadeau pour l’anniversaire d’une amie friande d’exotisme et de bizarreries. C’était l’occasion rêvée de visiter cette petite boutique de curiosités du centre – vous savez, ce genre de commerce étrange, poussiéreux, mal éclairé, dans lequel on ne voit jamais aucun client et dont les horaires d’ouverture sont incompréhensibles. Tout le monde en connait un près de chez soi.
Le carillon de la porte d’entrée m’annonça dans un joyeux tintinnabulement, un « bonjour » d’une voix alto âgée me salua depuis le fond du magasin. Un grand soleil rayonnait à l’extérieur, aussi mis-je quelques secondes avant de percevoir quoi que ce soit dans la lumière tamisée. Ça sentait la cire et le vieux papier, avec de vagues relents d’huile et de bois. La petite pièce était un labyrinthe de fourbi et de meubles divers, tous d’une propreté impeccable. Je saluai en retour la personne à moitié cachée derrière une archaïque caisse enregistreuse mécanique, et m’intéressai aux objets exposés.
Chacun d’eux était d’une étiquette soigneusement calligraphiée à l’encre violette, attachée avec une ficelle. Elle précisait la nature de ce à quoi elle était liée, mais n’indiquait pas de prix. Ce genre de considération terre-à-terre était sans doute gérée à la tête du client.
Il m’apparut assez vite que ce n’était pas un simple magasin d’antiquités. Il ne vendait aucune de ces babioles laides et inutiles que l’on trouve à presque rien dans tous les vide-greniers et pour une fortune chez les professionnels ; non, les produits de ce surprenant bazar étaient tout à fait uniques, et infiniment plus étonnants que tout ce que j’avais imaginé. Rien dans ce magasin n’était exactement ce qu’il semblait être. L’horloge grand-mère dont les aiguilles indiquaient la latitude et la longitude (selon le méridien de Paris) était amusante, mais un peu encombrante. Ce pendentif couleur de ciel (hélas couplé au temps d’Édimbourg) était joli, mais probablement beaucoup trop cher. J’hésitais : cette radio portable en bakélite qui captait les émissions d’il y a cinquante ans, ou bien un tampon encreur à offenses (un coup, une insulte, toujours différente et parfois en allemand) ?
Je réfléchissais lorsqu’à la faveur d’un éclat de lumière, je le vis, posé sur un menu coussin dans un coin discret. C’était un petit couteau, sobre, mais élégant, à la lame gravée, et dont le fil semblait luire d’un bleu profond. L’étiquette indiquait :
« Couteau à découper la membrane de la réalité ».
Puis, en dessous, dans une encre rouge inhabituelle pour le magasin :
« Manier avec précaution »
— S’il vous plait ? Ce couteau m’intrigue, pouvez-vous m’en dire plus ?
Une vieille femme voutée s’approcha en trottinant, chaussa des bésicles et colla son nez à l’étiquette.
— C’est un couteau à découper la membrane de la réalité, jeune homme, dit-elle d’une voix chaude, mais âgée. Il sert à sectionner le tissu de la réalité, et à voir ce qu’il y a au-delà.
— Ha. Et… qu’y a-t-il par-delà la membrane de la réalité ?
— Eh bien ! tout ce qui n’est pas réel, voyons.
C’était une question idiote, je dus le reconnaitre.
— Est-ce simple à utiliser ?
— Très. Regardez, je vous montre… (elle empoigna le couteau d’une main leste pour son âge). Vous pincez la réalité, comme ça…
Elle saisit quelque chose entre son pouce et son index, qui s’arrêtèrent à quelques millimètres l’un de l’autre.
— … puis avec la pointe du couteau, vous pratiquez une incision, que vous élargissez. Il faut manier la lame avec précaution, la membrane de la réalité est fine et fragile, et vous ne voudriez pas faire une grande déchirure. Et voilà. Tenez, regardez.
Une ouverture d’une vingtaine de centimètres, parfaitement nette et délimitée, flottait en l’air, et montrait… un monde différent ? Apparemment le rêve d’un enfant, d’après la scène qui se déroulait sous mes yeux.
— Et quand vous avez fini, vous saisissez les deux bords, et vous refermez, comme ça.
Elle joint le geste à la parole. Elle continua :
— La membrane de la réalité cicatrise très vite, mais il faut faire attention à ce que la brèche soit bien close, sinon…
— Sinon ?
— Ce qu’il y a de l’autre côté peut traverser.
— Ce serait grave ?
— Eh bien, ici c’est la réalité, jeune homme. Ce que l’on y trouve est donc réel, par définition. Même leurs jeux vidéos et ce qu’il y a, là, sur Internet, tout ça c’est réel, ça existe dans notre monde. Mais il y a des choses qui ne le sont pas et dont vous ne souhaiteriez pas qu’elles le deviennent. Vous lisez, mon garçon ?
— Ça m’arrive.
— Prenez Lovecraft, par exemple. (Elle m’agita un index accusateur sous le nez). Ça, c’est des échantillons de ce qu’on peut trouver si on incise au mauvais endroit. Et vous ne voudriez pas que ça vienne ici.
— Je pense avoir compris l’avertissement, oui. Le couteau m’intéresse. À combien le vendez-vous ?
La vieille femme m’annonça un prix tout à fait raisonnable. Elle m’expliqua que le couteau n’avait pas de vraie utilité : impossible de déterminer à l’avance quelle irréalité va débouler derrière l’ouverture de la membrane : fiction, illusion, délire d’une imagination débordante ou complètement clichée, rêve de n’importe qui ou n’importe quoi, visions… tout, absolument tout pouvait surgir sans qu’il soit capable d’influencer sur le résultat d’une quelconque manière.
Mais cela m’importait peu : mon amie se plaignait souvent de manquer d’idées pour ses illustrations, et voilà que j’avais déniché le cadeau parfait !
16 – Qui a assassiné l’astronaute ?
La radio capta quelques bribes de phrases hachées, un grésillement indistinct, puis plus rien. Merde. Le jour martien dure vingt-quatre heures, trente-neuf minutes et trente-cinq secondes, et chacune des secondes de celui-ci semblaient dédiées à la production de contretemps. Celui qui venait d’arriver rentrait dans la catégorie « catastrophique ».
Ce matin-là, Florence et Thomas étaient partis en mission depuis la base Jules Verne réparer une antenne-relai et relever les résultats d’expériences en cours. L’antenne, nécessaire à la navigation dans cette zone de Noctis Labyrinthus, était indispensable aux futures expéditions, mais avait un taux de pannes incohérent avec toutes les prévisions ; l’expérimentation devait déterminer ce qui pouvait provoquer de telles perturbations.
Ils avaient roulé dans la poussière rouille, admiré le paysage crevassé, et étaient arrivés à destination. Là, les ennuis avaient commencé : l’électronique de l’antenne grillée, sa batterie et ses panneaux solaires morts, le boitier de mesure contenant uniquement des résultats chaotiques… tout ce qui avait pu échouer avait mal tourné. Florence était donc retournée dans le véhicule pour récupérer du matériel supplémentaire lorsqu’elle capta la dernière communication de Thomas.
Elle avait gardé son calme – après tout, les perturbations électromagnétiques semblaient courantes dans la région, c’était précisément la raison de leur venue –, rassemblé les outils et composants nécessaires, puis revint à l’antenne. Thomas était allongé, un trou d’une dizaine de centimètres de diamètre lui traversant la poitrine de part en part. Du sang en ébullition s’écoulait lentement dans la chaleur de l’été. Devant sa réaction, l’intelligence artificielle du scaphandre de la spationaute lui injecta un cocktail de relaxants et d’antinauséeux. Le premier choc passé, elle sentit sa conscience se dédoubler pour ignorer la partie qui hurlait au secours, et observa la scène avec un détachement qui la mettait elle-même mal à l’aise.
Son premier réflexe lorsqu’elle récupéra le contrôle de ses actions fut d’appeler à l’aide, mais sa radio aussi ne répondait plus, y compris sur les fréquences de sauvetage satellitaires. Thomas était mort, et bien mort. Personne ne peut survivre à un tel trou, surtout quand il a emporté le cœur et tous les gros vaisseaux.
Elle devait se mettre en sécurité, mais de quoi ? Un arc électrique ? Non, même derrière le véhicule elle l’aurait vu, et les éclairs ne provoquent pas de pareilles ouvertures, y compris sur Terre. Un accident ? Si l’antenne était tombée sur le pauvre homme, elle serait restée plantée dedans, n’est-ce pas ? Et puis le pylône était intact. Alors quoi ?
Un débris spatial en perdition ? Non seulement il aurait fallu une malchance extraordinaire à l’astronaute (quoique les autres explications rationnelles impliquaient aussi une telle malchance), mais en plus il n’y avait aucune trace de météorite à l’horizon. D’autant plus que…
Florence se rapprocha du cadavre de Thomas. Le trou était absolument rond. Quel phénomène naturel et accidentel pouvait provoquer une ouverture si parfaite en plein cœur d’un homme adulte ? Peut-être qu’une violente décharge de plasma.
Quelque chose bougea au coin de son champ de vision. Elle se retourna, et vit un truc scintiller, et venir plus près d’elle. Un mouvement tout à fait incompatible avec la topologie ou les vents locaux. En un éclair, elle comprit, et au mépris de toutes les procédures se rua dans le véhicule et démarra, abandonnant tout le matériel et le corps de son camarade.
Roulant en trombe vers la base Jules Verne, elle appelait frénétiquement toutes les fréquences connues – sans réponse – parce qu’elle avait fait la découverte du siècle : Mars était habitée, et pas seulement par une vie humaine. Et surtout, ces autochtones tentaient de l’assassiner.
17 – La boite à rythmes de Pandore
Beaucoup d’entre vous connaissent l’histoire de la boite de Pandore. Mais combien savent qu’en réalité il s’agissait de la seconde boite ?
Alors, laissez-moi vous narrer le conte de la boite à rythmes de Pandore.
C’était au temps des premiers hommes, quand les Dieux régnaient sur le monde. Ce jour-là, Zeus, le roi des Dieux, ruminait sa colère sur son trône, car Prométhée avait volé le feu et l’avait donné aux hommes. Je dis « hommes » et non « humains » puisque c’était la vérité : les mortels étaient alors tous mâles, se reproduisant comme des céréales. Ils ne connaissaient pas la souffrance, la vieillesse ou la fatigue ; simplement parfois ils disparaissaient dans un sommeil paisible. Zeus, donc, eut une idée : une vengeance qui châtierait les auteurs de cette trahison. Ainsi il convoqua les autres Dieux, et distribua quelques ordres.
Héphaïstos prit de la glaise et de l’eau, et en façonna le corps d’une femme, première de son genre ; un être à la beauté ravissante qui égalait celle des déesses. Puis, dans un souffle, il lui prodigua la force, la voix et la vie.
Il la présenta ensuite à Athéna. La déesse de la sagesse, de la stratégie et des artisanats lui enseigna l’art du tissage, et tous les travaux qui incomberaient aux femmes par la suite. Les trois Grâces l’habillèrent de riches vêtements et de leurs dons.
Vint après la seconde partie du plan de Zeus. Il demanda à Aphrodite de parachever la beauté de la première femme ; mais aussi les désirs les plus forts, avec tout ce qu’ils ont de moteur, d’exubérant et de dévorant. Puis le roi des Dieux fit mander Hermès, messager des dieux entre bien d’autres titres.
Or, et c’est là que commence le fragment méconnu de l’histoire, Hermès n’arriva pas. Il était sur une falaise en surplomb de ce qui deviendrait la mer Égée, la première femme à ses côtés. Celle qui n’avait pas encore de nom s’ennuyait : on ne lui avait pas présenté les hommes, elle n’avait pour unique compagnie qu’une poignée de Dieux hautains et compliqués qui ne prêtaient aucune attention à une simple humaine.
Le messager des dieux l’avait vue, seule, assise sur sa corniche, à essayer de tuer le temps comme elle le pouvait – mais aucun des jeux, aucune des distractions d’aujourd’hui n’avait déjà été inventée ; et aucune divinité n’avait insufflé la curiosité ou l’imagination à cette pauvre femme.
C’est pourquoi Hermès l’avait prise en pitié. Il lui avait fait don d’une lyre. Intriguée puis amusée par l’instrument, elle le gratouillait, sans en tirer le moindre son cohérent. Le Dieu eut une idée, mais la convocation de Zeus tonna dans le ciel, l’empêchant de la peaufiner. Alors il créa une boite et l’offrit à la femme en disant :
— Prends ceci, et ouvres-là dès que je ne serai plus à tes côtés. Elle contient un présent qui te permettra d’occuper agréablement le temps qu’il te reste à passer seule.
Puis il fila sur le mont Olympe.
La femme regarda le cadeau du Dieu. C’était un petit cube en bois sombre, à peine plus grande que sa main, sobre et élégante, munie d’un fermoir en cuivre. Et comme Hermès le lui avait demandé, elle l’ouvrit.
Alors dans un immense souffle s’en volèrent les vers et les pieds, les accents toniques, les notes et les silences, les cadences, les syncopes et séries régulières, et toutes les sortes de rythmes qui donnent les multiples pulsations de la vie humaine. Et la femme, émerveillée, se saisit de la lyre et chanta le cadeau du Dieu : Hermès lui avait offert la boite à rythmes, et maintenant son existence avait du sens.
C’était là l’histoire de la première et inconnue boite de Pandore. Après s’ensuit le mythe habituel de la première femme qui par vengeance apporte le malheur et la discorde aux hommes, un récit tellement suranné et surexploité qu’on trouve même un album des Schtroumpfs sur le sujet.
18 – Nu de bon gout
Il était arrivé chez la jeune femme tôt dans la soirée. Un bien curieux appartement de centre-ville, aux plafonds à moulures, mobilier début XXème, pièces exigües et papiers peints défraichis. S’il ne connaissait pas les deux colocataires, il aurait aisément parié sur le fait que le lieu appartenait à un couple de petits vieux.
Et maintenant les ressorts du matelas massaient délicatement son dos nu tandis qu’il savourait l’odeur fleurie des draps lavés et repassés de frais. Au pied du lit, devant une large armoire à glace, la jeune femme hésita un instant et décrocha une agrafe. En une ondulation, sa jolie robe noire chut au sol dans un froufrou soyeux. Un sourire radieux resplendit sur ses lèvres carmin ; elle détacha une épingle et une cascade de longs cheveux aile de corbeau noya ses épaules et sa poitrine.
L’homme dans le lit, immobile, apprécia le spectacle. Il dépassait tous les fantasmes et espoirs qu’il avait pu nourrir depuis qu’il avait accepté l’invitation impromptue.
D’un geste gracieux et nonchalant, elle éteignit le plafonnier, ne laissant plus que la chaude lueur de la lampe de chevet dans la pièce – un éclairage qui suggérait plus qu’il révélait, idéal pour l’ambiance. Puis avec une souplesse toute féline, elle grimpa sur le lit, sur lui ; ses cheveux lui balayèrent la tête dans une tornade de chatouilles, de pêche et d’abricot. Il n’osa bouger, de peur de rompre le charme, incapable de réaliser l’évidence de la situation. Elle s’approcha encore. Il sentit son souffle glisser sur son cou puis son visage, la douceur moelleuse de ses seins sur sa poitrine, de ses cuisses enserrant les siennes.
Alors il plongea son regard dans ses yeux bleu outremer, admira les papillonnements de ses longs cils, se délecta du velouté de sa peau pâle, de son odeur d’amande, de l’aspect rieur de ses pommettes ; il entreprit de laisser courir ses doigts sur la ligne parfaite de la mâchoire, le long de son épaule, puis plus bas encore.
Le premier baiser qu’elle lui offrit avait le gout de cannelle des Zimtsterne ; le second, au creux de sa clavicule, fut l’étincelle qui ouvrit le chemin vers l’extase.
* * *
— Tu es obligé de faire tout ce cirque chaque fois que tu bois une canette ?
— D’une, je fais bien ce que je veux. De deux, le sang n’est bon que sur un homme nu, et n’est jamais aussi savoureux qu’après l’acte. De trois, comme ça ils reviennent et sont heureux de le faire, pas besoin de chasser. Et de quatre, traiter les humains de « canettes » est dégradant.
— Oh, voilà que mademoiselle s’intéresse au bienêtre du bétail, maintenant. Allez, bouge-toi, on va être en retard.
Avec une expression exaspérée à destination de sa colocataire, la jeune femme parcourut ses dents de son pouce pour s’assurer que ses canines étaient bien rétractées, vérifia qu’aucune trace de sang sur son visage n’effraierait les passants, enfila une veste et sortit.
* * *
Il se réveilla dans le lit exigu de son petit appartement, seul. Bien que les gros chiffres verts du cadran prétendaient qu’il était onze heures du matin passées, il se sentait épuisé, et gêné par des piqures de moustique sur le cou. Il réfléchit à la soirée de la veille. Impossible de se rappeler comment il était rentré, ni même pourquoi il était revenu. Mais malgré la fatigue et l’heure indue, il se saisit de son smartphone et vérifia ses contacts : il devait revoir cette femme.
19 – Un ciel à l’envers
Le redémarrage de la propulsion fut comme un coup de pied au cul, mais qui ne s’arrêta pas. Fini, le silence relatif du module en vol libre ; terminées les sensations surnaturelles de l’impesanteur. Nadia subissait trois G – trois fois l’attraction terrestre. Et, comme les dix-sept autres personnes de l’équipage qui n’étaient ni le commandant de bord ni le pilote, elle n’avait rien à faire. Alors elle regarda par le minuscule hublot, trop petit, mais déjà bien plus grand que celui installé sur les antiques missions des débuts de l’exploration spatiale.
En haut du cadre, la Terre, les verts multiples des forêts, ses montagnes enneigées dispersées comme des fractales blanches ; le bleu profond de la mer, la matière cotonneuse des nuages, le reflet du soleil dans un fleuve. Ici la glace d’un pôle quelconque ; vingt minutes plus loin les ocres d’un désert surchauffé. Parfois, de-ci, de-là, la fourmi d’une gigantesque construction humaine. Puis, sous cette titanesque portion de sphère colorée, minuscule et fragile, la ligne cyan de l’atmosphère, protection dérisoire vue de si haut, et pourtant indispensable à la vie. Et pour finir, en bas du cadre, le noir du vide, que le contraste avec la luminosité éclatante de la planète privait de toutes ses étoiles.
La Terre au sommet, l’Espace en bas. Un ciel à l’envers. Et celui-ci était naturel – il était toute la nature, dans son intégralité.
Enfin, ou déjà, apparut à côté du globe le long cigare oblong du vaisseau mère, son univers pour les cinq années futures. La station était maintenue en rotation le long de son axe pour créer une gravité artificielle. Nadia, comme le reste de l’équipage, tous ceux présents et les équipes à venir, vivrait sur la face interne. Deux larges baies latérales pour laisser rentrer le soleil, panneaux opaques montés face à face pour accueillir sols, eau, plantes, animaux et humains. Leur ciel aussi serait sens dessus dessous, une Terre synthétique flottant en permanence au-dessus de leurs têtes, étrange rappel construit de la véritable, visible par les ouvertures.
Un ciel à l’envers ? se dit Nadia. Et si c’était plutôt celui de tous les terriens qui n’était pas dans le bon sens ?
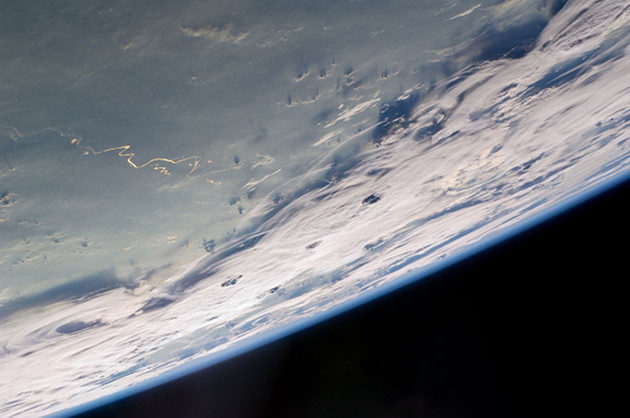
Illustration de la NASA, dans le domaine public.
20 — La préquelle de la Bible
Corrigé de l’interrogation d’histoire du vendredi 27 mars
Vérification des connaissances sur les Grands Schismes. Composition de 2 heures, notée sur 20 points.
Question 1 : décrivez les évènements qui ont mené aux Grands Schismes. (5 points)
Les Grands Schismes sont le fruit de la découverte de la Préquelle de la Bible, évènement qui devint par la suite l’an un du nouveau calendrier. Ces papyrus exceptionnels, parfaitement conservés et trouvés en Isralestine, prouvent que la Bible et la Torah sont des œuvres de fiction, et soulèvent le doute sur le cas du Coran. Les analyses menées par des dizaines d’équipes indépendantes du monde entier ne réussirent qu’à démontrer l’authenticité de ces documents.
La découverte de nouveaux livres, eux aussi authentifiés et considérés comme des récits inventés achevèrent d’enflammer les débats.
Détails complémentaires attendus : dates et lieux de découvertes de la Préquelle de la Bible et des manuscrits supplémentaires, commanditaires des principales équipes scientifiques, mention de la datation au carbone 14 et de l’athéisation des pays occidentaux.
Question 2 : que sont les Grands Schismes et quelles furent leurs principales conséquences ? (5 points)
Les Grands Schismes sont les incompatibilités de croyances qui apparurent dans les religions abrahamiques suite à ces découvertes. Les trois principales conséquences sont :
- Le schisme de toutes les versions de toutes les religions abrahamiques en deux ou trois variantes chacune.
- La création des nouvelles religions.
- Les guerres religieuses qui s’en suivirent.
Détails complémentaires attendus : au moins deux exemples de variantes schismatiques, au moins deux exemples de nouvelles religions, au moins deux exemples de guerres de religion (de cette époque !).
Question 3 : donnez un exemple d’évolution d’une religion majeure suite aux Grands Schismes. Expliquez les raisons de cette évolution. (5 points)
Les répartitions sont différentes selon les religions et pays d’origine, mais le découpage souvent est presque toujours vérifié :
- Création d’un courant conservateur qui nie complètement l’authenticité de la Préquelle de la Bible, et le l’inclus pas à ses textes sacrés.
- Création d’un courant progressiste qui accepte l’existence de ces nouveaux textes et les inclut à leurs textes sacrés, sans pour autant en reconnaitre le caractère fictionnel.
- Création d’un courant fictionnel, qui accepte que les textes n’aient aucune réalité, mais pense que le message mérite que la religion s’appuie tout de même sur ces documents.
- Et forte diminution de l’adhésion à ces religions.
Détails complémentaires attendus : au moins un exemple de chaque courant.
Question 4 : que sont les nouvelles religions et quel rapport ont-elles avec les Grands Schismes ? (5 points).
Les nouvelles religions sont des religions construites à partir de la découverte de la Préquelle de la Bible, et fondées sur des textes ou autres médias de fiction. L’argument qui préside à la création de ces religions est que si les plus grandes d’entre elles sont fondées sur un texte qui' n’a rien d’authentique, rien n’empêche de créer une religion depuis n’importe quoi. Ces religions se sont surtout développées dans les pays occidentaux et au Japon. Leur officialisation est très variable selon les états.
Des religions anciennement parodiques se sont aussi considérées comme véritables, car reposant sur des bases d’un même niveau de crédibilité.
Détails complémentaires attendus : au moins trois noms et œuvres d’influences de nouvelles religions, dont au moins un parmi : Les Magiciens (Harry Potter), Les Adorateurs de Spock (Star Trek), Les Jedi (Star Wars), Les Tarentinesques (films de Quentin Tarentino). Au moins deux exemples de religion auparavant fantaisiste, dont un parmi : le pastafarisme, la Licorne Rose Invisible, la Théière de Russel.
21 — La banane impossible
Évariste badaudait dehors par cette douce soirée vernale. Tout était calme sous l’empyrée céruléen ; la bananeraie s’illunait et froufroutait du friselis du zéphyr entre les brouts, odorait le pétrichor après l’ondée vespérale. L’aménité de la thébaïde délectait énormément le jeune homme, suscitait chez lui des réminiscences du passé.
C’est alors qu’il avisa la banane, énormantesque fruit sinople tavelé de pers, pendant d’un plan squalide isolé, presque photogène dans l’air hyalin. Hétéroclites couleurs, était-il porteur de synopsie ? Ou était-ce une magie ? Son imagination ubéreuse s’ébranla, cherchant une élucidation à ce mystère abscons. Puis, constatant sa nescience la plus crasse, le béjaune dégaina son eustache contadin et cueillit l’impossible baie amylacée, bien déterminé à la livrer à un polymathe.
Au loin arrivait une péronnelle callipyge qui le huchait. Il s’efforça de lui répliquer, mais n’enfanta que d’un logogriphe fuligineux. Comme elle mostait avec un regard cauteleux, il inclina pour la méfiance, et compta reculer. Mais à cause de la briserve qui infunait du sol, il décreva et s’assomma à moitié à terre.
Il rouvrit les yeux, et il vit Osange. Le visage de la jeune femme, tout près du sien, transpirait l’inquiétude.
— Évariste ? Tout va bien ? Tu as fait un malaise ?
— Heu… je crois que j’ai fait un rêve bizarre, ou une sorte de magie. J’étais là, et quelqu’un commentait mes faits et gestes, mais je ne comprenais rien de ce qui était raconté. C’est devenu de plus en plus étrange, mais très réel, et puis tu es arrivée.
— Peut-être bien une sorcellerie, c’est plein de démons ici la nuit. Ils te susurrent ce que tu fais à l’oreille, et te poussent à faire n’importe quoi en te faisant voir ce qui n’existe pas.
— Ha ? J’ai eu de la chance. À moins que…
— Ne t’inquiète pas, je suis arrivée à temps. Et puis, savoir ce qui était réel ou pas est théoriquement aisé.
— Ha bon ?
— Oui, les démons ne peuvent décrire des actions véritables qu’avec des mots qui existent. Donc ils utilisent des verbes inventés pour déclencher leurs illusions.
— C’est facile, alors.
— Ce serait simple, s’ils n’avaient pas autant de vocabulaire.
22 — Le poisson qui rêvait d’une planète lointaine
Omble nageait. C’était sa principale occupation, et son unique mode de déplacement, car Omble était un poisson. Lorsqu’il se mouvait, il allait d’ordinaire près de la grosse algue, puis longeait le champ de force sur toute sa longueur, dépassait les cailloux bizarres par la droite, slalomait entre les branches de pierre, esquivait la grande loupe (ou s’y attardait, selon son humeur), et… se retrouvait à la grosse algue.
Car Omble était un poisson d’aquarium et partageait ses quelques mètres cubes de liquide avec plusieurs autres spécimens. Oh, il ne se plaignait pas, il sentait bien que les humains qui l’avaient placé là ne voulaient que son bien : température idéale de l’eau, éclairage parfait, nourriture abondante et de qualité… si Omble avait eu une quelconque appétence pour les métaux précieux, il aurait qualifié son bassin de « doré ». Son sort aurait pu être bien pire : poisson sauvage à la merci des éléments et des prédateurs ; poisson d’élevage, de bocal, ou l’enfer des enfers : un morceau de surimi.
Mais Omble était d’une espèce rare et protégée, et donc seul représentant de sa race dans un aquarium décent, mais à l’horizon limité. Qu’il devait de plus partager avec Gertrude, une sorte de plie acariâtre qui en squattait le fond – et d’autres locataires sympathiques, quoique peu bavards.
Alors, pour passer le temps, Omble rêvait. Il n’avait qu’un seul rêve, en réalité, c’était un petit poisson, mais cette unique échappatoire systématiquement ressassée sous de multiples variantes lui suffisait à s’évader.
Dans ses songes, il occupait une planète lointaine – jamais la même, toujours très loin. Cette planète possédait d’immenses océans, parfois un réseau labyrinthique de fleuves et rivières. Et lui, Omble le Chevalier, parcourait ce globe exotique en tous sens pour terrasser de terribles requins, sauver moult poissons-princesses, vivre heureux et engendrer des millions d’alvins.
Omble chérissait ce fantasme, dans lequel il était libre, puissant et aimé ; mais le détestait aussi. Car à chaque fois qu’il se réveillait, c’était pour se retrouver dans cette cage, observée de toutes parts par des singes nus grimaçants. Et à chaque nouvel éveil, l’aquarium lui semblait plus petit.
Seule grandissait sa hâte de se rendormir et de rêver d’une planète lointaine.
23 — Un très curieux dirigeable au-dessus de Venise
Ce jour-là, Venise était en effervescence. Quelque chose flottait au-dessus de la ville, une gigantesque vessie oblongue et fuselée, sous laquelle l’on avait accroché une longue nacelle tressée d’osier. « On » devait être la République, car l’objet étranger était paré de ses couleurs et décoré de ses armes, tel un titanesque étendard volant.
L’engin se mouvait avec paresse au-dessus de la cité quand, parvenu au droit du Palais, il s’arrêta et descendit lentement. Les bateliers s’agglutinaient dans les canaux alentour, la place Saint-Marc se remplissait de badauds curieux du spectacle. Lorsqu’il atteint une altitude suffisamment basse, le ballon largua une amarre et s’accrocha au bâtiment ; une nacelle garnie de coussins en descendit. Le Doge en personne s’y installa, puis le tout remonta à l’aéronef. À ce moment, le chef, posté depuis un perchoir jusque là jamais égalé, s’adressa à la foule d’une voix forte :
— Bon peuple de Venise ! L’invention que vous voyez là s’appelle « dirigeable », et j’ai personnellement acquis le premier exemplaire !
Il y eut des vivats dans l’auditoire.
— Ce nouveau moyen de locomotion va porter dans les cieux la puissance de la République de Venise, visible à des lieues à la ronde ! Elle nous assurera le contrôle militaire de toute la plaine du Pô comme de l’Adriatique, et au-delà !
Cris de joie et de fierté accompagnèrent ces assertions.
— Moyen de diffusion exceptionnel, libéré des contraintes terrestres en passant par les airs, il révolutionnera le transport et le commerce.
Les applaudissements se firent plus rares : beaucoup dans le public étaient marchands ou gondoliers, et n’avaient pas envie d’être révolutionnés.
— Bientôt, le monde entier nous jalousera et achètera notre technologie. Vive la République, vive Venise !
Les acclamations reprirent de plus belle, et l’étrange dirigeable se détacha de ses amarres pour une parade à basse altitude au-dessus de toute la ville. Le Doge, plus heureux que jamais, souriait et saluait à tout va.
Arrivés au pont du Rialto, ils effectuèrent même une halte, démontrant les capacités de sustentation et de manœuvrabilité aux innombrables commerçants et passants qui occupaient l’endroit. Dans la manipulation, ils dérangèrent un groupe de goélands qui avait ses habitudes à cet endroit.
L’un des gabians, énervé, se posa sur la vessie géante et l’attaqua. Son bec, puissant rasoir crochu, perça la fine membrane, qui commença à se dégonfler dans un sifflement atroce. Sous les yeux d’un public aussi nombreux qu’abasourdi, l’engin parti dans un vol erratique de plus en plus rapide et chaotique, avant de s’écraser dans la lagune. Les gaz du ballon, légers, mais terriblement explosifs, détonnèrent en une gigantesque boule de feu.
Debout sur leurs gondoles près de l’un des quais, deux bateliers discutaient.
— Pas au point, cette invention, si tu veux mon avis.
— Ouaip. M’a l’air un poil dangereux. Et pas très fiable.
— Percée par un seul gabian… sales bêtes !
— Ouaip. M’est avis qu’y va falloir élire un nouveau doge…
24 – Ce chat me donne la chair de poule
— Tiens ? Tu as un chat toi ?
— Oui, je ne te l’avais pas dit ? me répondit mon amie de son accent chantant. Je l’ai trouvé à ma porte il y a trois semaines, tout ensuqué sous le cagnard. Pauvre bête ! Alors je l’ai laissé rentrer, et il est resté.
Le félidé susmentionné dormait sur le canapé du séjour. Je finis d’entrer.
— Il s’appelle Léone. Il est mignon, non ?
L’animal, à l’énoncé de son nom, dressa une oreille. Pour ce que j’en voyais, il roupillait en rond et me présentait son dos, ne me permettant pas de juger de son apparence ; aussi ne répondais-je pas.
— Installe-toi, je vais chercher de la picole.
À peine fus-je seule dans la pièce que le mammifère se réveilla tout à fait et me dévisagea. J’empiétais sur son territoire, et il me toisait. Intrus ? Je semblais toléré par l’humaine qui squattait les lieux. Prédateur ? De toute évidence, non. Proie ? Sans aucun doute. Il bâilla et s’étira, les pattes avant plantées dans le tissu du sofa, et cette exhibait ses griffes acérées et ses crocs pointus.
Puis le fauve s’assit et me regarda en se léchant les babines.
Elle revint avec deux bières fraiches qu’elle posa sur la table basse.
— Hooooo ! Il est réveillé ! Viens là, petit père !
L’animal, qui avait feint une toilette nonchalante dès qu’elle était arrivée, fut submergé de papouilles et de bisous, qu’il accepta sans grogner, à ma grande surprise.
* * *
La soirée avança, et, affalés dans le canapé, nous regardâmes un film. Le félin s’était installé sur les genoux de mon amie, et de temps en temps s’étirait et en profitait pour me planter ses griffes dans la cuisse. Lorsqu’il daigna bouger, ce fut pour s’établir sur le haut du dossier – et me marcher sur l’entrejambe en passant.
L’animal avait bien planifié : depuis son nouveau perchoir, il avait toute latitude pour m’ennuyer de toutes les façons possibles (coups de queue, attrapage de cheveux, petits coups de patte sur la branche des lunettes…) sans que personne ne puisse le prendre en flagrant délit ni lui reprocher quoi que ce soit. Même une activité d’apparence aussi inoffensive que sa toilette nécessita qu’il s’appuie de manière fort désagréable sur mon crâne.
— Je crois que ton chat me hait, dis-je à l’occasion de mon dix-septième dérangement.
— Impossible, il est trognon ! me répondit-elle.
— Mrrrr ? fit l’intéressé.
Cette ordure avait compris ce que je disais de lui et imitait à la perfection un sphinx angélique.
* * *
Quelques heures plus tard, la soirée était finie, et vint l’heure de dormir. Le sinistre prédateur squattait mon oreiller, affalé tout en travers de ce dernier, et s’était de toute évidence donné pour mission d’y étaler autant de poils qu’il en était félinement possible.
— Allez, bouge ! lui dis-je.
Aucune réaction. Je m’approchai ; souvent dans ce cas les chats détalent, lui continuait à pioncer.
— Ouste ! C’est mon lit !
Devant la mauvaise volonté de la bestiole, je secouais la couette. Alors enfin il ouvrit un œil, puis le second, puis me fixa de son étrange regard jaune aux pupilles verticales. L’expression qui se lisait en lui était limpide, et ne disait rien d’autre que : « Cette nuit, je boirai ton âme ».
Puis avec cette souplesse surnaturelle qui n’appartient qu’à ceux de sa race, il se leva et sortit de la pièce. Je me brossai les dents, tentai vainement de nettoyer l’oreiller de ses poils, et fermai soigneusement la porte. Que la bête reste à distance, et que toute divinité qui m’existe m’autorise à passer une nuit tranquille, en sécurité !
* * *
Je commençais à somnoler, quand le battant s’ouvrit dans un déclic.
Le visage de mon amie apparut, faiblement éclairé par la lampe d’une pièce lointaine.
— Je laisse ta porte entrebâillée. C’est pour le chat.
Puis, avec un grand sourire :
— Bonne nuit !
25 – Parachutisme sur Neptune
Confortablement assis dans d’élégants fauteuils club, les deux multimilliardaires sirotaient un excellent Cognac et planifiaient.
— D’accord, dit l’un, cette idée de croisière interplanétaire est réalisable, grâce aux nouveaux moteurs à propulsion Pitjeva. Reste le cas des escales : les clients vont vouloir visiter, faire diverses activités.
— Pour la cible des jeunes sportifs aisés, j’avais pensé au parachutisme. J’imagine d’ici les affiches en quatre par trois au bord des autoroutes : « Faites du parachutisme sur Neptune, dernière planète du système solaire ! »
— Les Américains ne vont pas apprécier ce slogan.
— On leur en trouvera un différent.
— Mais j’aime beaucoup l’idée et les marges qu’on peut en tirer.
— Avec un markéting bien ciblé, ça va être l’activité à ne pas louper pour qui voudra être hype.
— Reste à voir la faisabilité technique… j’appelle le conseil scientifique…
L’autre, d’une commande vocale, modifia le décor affiché par les murs-écrans.
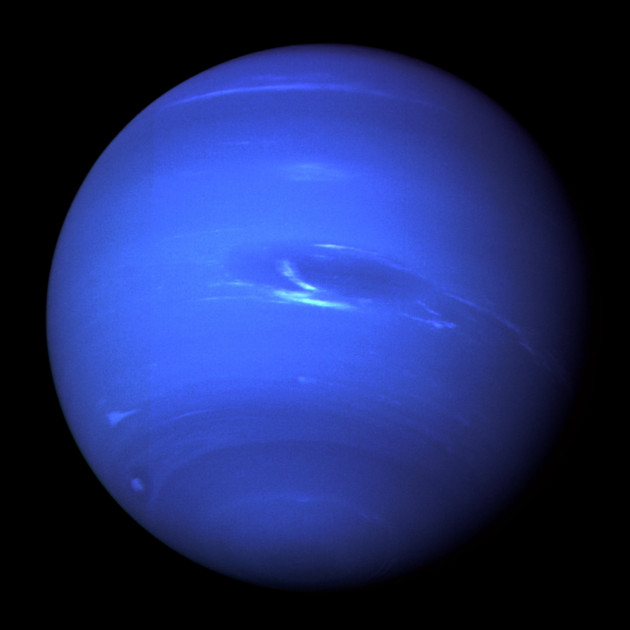
— Service scientifique, j’écoute ?
— Bonjour, on a un projet de parachutisme sur Neptune. Quelles sont les possibilités ?
— Je crains qu’elles ne soit faibles, pour ne pas dire nulles, chef.
— J’ai une rentabilité à étudier. Soyez plus précis.
— Bien. En admettant que vous arriviez là-bas, vous devrez vous placer en orbite autour de la planète, puis ralentir assez pour vous mettre en conditions d’atterrissage. Ça, avec les technologies modernes, c’est la partie facile.
– Continuez.
— Ensuite, les personnes parachutées devront être vêtues de scaphandres intégraux. L’atmosphère est complètement irrespirable, sur Neptune.
— C’est gênant, je pensais qu’avec une belle couleur bleue comme ça… bref, poursuivez.
— Puis viendra le froid. Il peut y faire jusqu’à moins deux-cent-dix-huit degrés.
— Admettons que les scaphandres soient chauffés.
— Compris, chef. Il y aura aussi le vent. On en a mesuré à près de six-cents mètres par seconde.
— Deux fois plus qu’un ouragan terrestre ? C’est beaucoup.
— Dix fois plus, en réalité. Dix-cent mètres par seconde, ça fait plus de deux-mille-deux-cents kilomètres par heure.
— Ah… d’accord. On va viser les endroits calmes.
— Alors il va falloir prévoir quelque chose pour récupérer vos parachutistes, parce que Neptune n’a pas de sol à proprement parler, c’est surtout une énorme boule de gaz de plus en plus dense et chaud au fur et à mesure qu’on s’enfonce. Enfin, techniquement il y a un noyau au milieu, mais d’ici là vos clients seront morts broyés par la pression et cuits par la température, après huit-mille kilomètres de plongeon.
— Ce ne serait pas très bon pour l’image de l’entreprise, je pense. Je déteste la science, trop de contraintes.
— Moi de même, fit le second milliardaire ; au moins les humains peuvent s’acheter.
— Imaginons, repris le premier, que nous ayons des scaphandres climatisés résistants à la pression ? « La plus longue descente en parachute », ça serait beau non ?
— Je crois que vous n’avez pas pris conscience des températures et des pressions en jeu, monsieur. Aucun matériau n’y survivrait. Il s’agit de conditions capables de provoquer des grêles de diamants.
— De diamants, dites-vous ? Je pense que je viens d’avoir une idée…
Image : Neptune par Voyager 2, NASA, domaine public.
26 – Le sol est de la larve
— Qu’est-ce que tu peins ?
— Une illustration d’un livre pour enfants. Là, les protagonistes s’amusent ensemble, le dessin représente ce qu’eux voient.
— Ça a l’air bizarre comme loisir. Ils sont perchés sur le canapé, et le sol brule ?
— Oui, tu n’as jamais joué à « le sol est de la lave » avec tes frangins quand tu étais gamin ?
— De la lave ? Le jeu c’est « le sol est de la larve » non ? C’est dégoutant une larve, d’autant plus si on les écrase…
— Je n’ai jamais entendu cette variante, tout le monde dit « de la lave ».
— Oh. À tous les coups, c’est mon crétin de grand frère avec ses expressions à mort-molle-nœud, il m’a encore enduit d’horreur !
27 – Ce qui t’effraie le plus
Je connais Lucie depuis plus longtemps que n’importe qui, à l’exception de mes parents. Lucie, à l’origine, c’était la fille des voisins, née quelques jours avant moi. Puis elle est devenue une gamine adorable, ma meilleure amie, une superbe adolescente, et avant que je m’en rende compte, mon premier crush. Qui, à ma déception puis à mon soulagement, n’a rien donné : Lucie avait une passion dévorante et fusionnelle pour les vieilles histoires, les antiques contes, les textes d’horreur et de fiction. L’intégralité de l’univers – y compris parfois sa propre santé, sa famille et ses camarades – passait après ses bouquins, dont elle posséda très tôt une collection impressionnante.
Mais cela m’importait peu, parce que Lucie était une amie très chère – le genre de personne qui vous fait sentir comme dans un bon bain chaud par sa seule présence. En réalité, si j’avais picoré à droite et à gauche, j’avais surtout acquis la certitude qu’elle seule m’intéressait réellement, qu’avec elle seule nous pourrions partager nos vies. Une petite voix cynique susurrait parfois dans mon esprit que j’avais ma chance, car il semblait que j’étais l’unique personne qui semblait supporter plus de deux semaines sa passion débordante pour les vieux livres.
Nous étudiions donc dans la même ville lorsque, pour la première fois depuis toujours, je ne la croisai pas à l’université. C’était particulièrement étrange : Lucie adorait ses études d’archiviste ; et lorsque par malheur elle était si malade qu’elle ne pouvait pas assister aux cours, elle trouvait au moins la force de me prévenir. Je me rongeai les sangs toute la journée, au grand dam de mon binôme de travaux pratiques. Elle restait injoignable. Sitôt la journée finie, je me ruai chez elle. Sur le chemin, je réfléchissais aux dernières semaines : elle m’avait semblé plus distante, apathique peut-être, mais j’avais mis ça sur le compte de la fatigue et d’études prenantes. S’il y avait autre chose, j’aurais dû le constater, non ? Je la connaissais depuis toujours. Je l’aurais forcément remarqué.
Elle est chez elle – du moins il y a de la lumière, mais elle ne répond pas lorsque je sonne à l’interphone. Aucune importance, je possède un double de ses clés, j’ouvre en priant ne pas la déranger en galante compagnie, tout en sachant que c’est très improbable.
— Jacquemin ? C’est chouette que tu sois là !
Jacquemin, c’est moi, et je n’ai toujours pas pardonné mes parents. Quant à Lucie, elle se tient devant moi, habillée dans un vieux pyjama rose difforme qui ne parvient pas à l’enlaidir. Son expression, elle, ne ressemble en rien à ce que je lui connais, et dément formellement ses paroles.
— Je… Qu’est-ce que tu… Est-ce que tu veux boire quelque chose ?
Ça non plus n’est pas normal, pas plus que ses yeux rougis et son sourire forcé – d’ordinaire, elle me propose systématiquement et d’emblée une bière blonde. Je lui réponds en parcourant rapidement le studio du regard. Le clic-clac est ouvert, la couette en vrac. Elle a agencé un montage bizarre avec ses livres dans sa bibliothèque, mais je n’ai pas l’occasion de voir ça de plus près.
— Tiens, ta bière.
Elle ne l’a pas décapsulée ni n’a sorti son éternel limonadier bleu roi. Elle reste là, debout, devant le frigo mal refermé ; son regard embué alterne entre la porte d’entrée et moi.
— Tu ne prends rien ?
Elle fixe ses mains, comme si elle découvrait qu’effectivement elles sont vides, puis les cache derrière son dos.
— Non. Je n’ai pas soif.
— Comme tu veux.
Je décapsule ma canette. Elle reste là, debout, sans bouger, un sourire artificiel plaquer sur son visage. Elle se retient de pleurer. Je pousse la couette, m’assieds sur la banquette et lui fais signe d’en faire autant ; elle hésite et se retrouve à mes côtés. Je réfléchis à comment aborder le problème, mais Lucie me devance :
— Pourquoi tu es passé me voir ?
— Je m’inquiétais, tu n’es pas venue en cours et tu n’as pas répondu à mes messages.
— Il ne fallait pas. Je vais très bien.
— Lucie…
— Je t’assure. Ça ne servait à rien que tu te déplaces, je n’en vaux pas la peine. Tu n’aurais pas dû.
— Hein ? Mais bien sûr que si ! D’où est-ce que tu sors une idée pareille ?
Elle regarde vers sa bibliothèque, comme si elle y cherchait le réconfort, ou une réponse à une question, ou une confirmation.
— Jacquemin… Qu’est-ce qui t’effraie le plus ?
Qu’elle disparaisse de ma vie, qu’elle soit malheureuse – mais je ne peux pas lui répliquer ça. Je baragouine un truc incompréhensible pour me donner le temps de réfléchir alors qu’elle se laisse tomber en arrière. Allongée sur le dos sur le clic-clac déplié, je la sens farfouiner sous la couette.
Elle se redresse d’un coup, d’un mouvement que je pensais impossible, et me serre dans ses bras. Elle tremble. Elle m’étreint avec force, une pression dont je ne la savais pas capable et qui n’arrive pas à être désagréable. Je ne vois pas son visage, mais je ressens son souffle tiède et mentholé contre ma joue et mon oreille, son visage doit frôler le mien.
— J’ai peur, Jacquemin. Je suis terrorisée.
Je saisis sa main – la gauche – et tente de la rassurer par mon attitude, aucun mot ne me vient.
— Parce qu’ils savent, ils ordonnent, et je ne suis pas digne. Je suis bonne à rien, mais ils ne veulent rien savoir, alors il me reste une solution.
Que… quoi ? Qu’est-ce qu’elle raconte ? Ça n’a aucun sens, mais ça pue la merde comme discours. Je n’ai pas le temps de réagir, je sens son bras droit qui me libère ; dans un murmure tremblotant, elle me susurre :
— Pardon.
La douleur flashe comme un éclair et disparait. J’aurais dû crier – peut-être que je hurle sans m’en rendre compte ? Non.
Le sang coule, chaud, moite et poisseux, et c’est le mien. Il n’est pas à sa place, normalement, il est dehors, là il est dedans. Je sais que cette réflexion n’est pas logique, mais je la fais quand même.
À mes côtés, Lucie pleure.
Je devrais hurler, mais ça attirerait les voisins, qui attireraient des ennuis à Lucie. Et elle disparaitrait. Je ne veux pas qu’elle disparaisse. C’est ça qui m’effraie le plus. Je n’ai plus la force de crier.
Lucie pleure à côté de moi.
J’ai froid.
28 – Le secret le plus intime
Lucie. C’est ainsi que m’appelle la race de singes nus qui hante cette planète, et c’était le premier indice vers la sublime et terrifiante vérité, car ce prénom qui m’a été donné signifie « Lumière », et c’est précisément pour apporter cette lumière aux Voyageurs que j’ai été incarnée ici.
Dès que les capacités de raisonnement de mon corps d’emprunt permirent à mon âme de s’épanouir, j’acquis la conviction que je n’appartenais pas et que je ne pouvais en aucune façon appartenir réellement à cette race abjecte, suicidaire et illogique qui prétend gouverner ce monde au point d’être persuadée en maitriser les éléments. Mais qui étais-je en vérité ? Impossible de m’en souvenir, impossible de le savoir sans indices extérieurs ; seule restait les premières années une certitude profondément enracinée que je ne pouvais pas faire partie d’un peuple autant dément et autodestructeur, et chaque nouvelle, lointaine ou proche, que j’apprenais de partout sur le globe, chaque rencontre d’une autre personne, quel que fût son âge ancrait un peu plus mon assurance. Il fallait que je comprenne qui j’étais réellement, la raison de ma présence sur une planète aussi désastreuse, et ce alors que je ne savais pas si mon amnésie à ce sujet était un effet indésirable de mon transfert ou un comportement normal qui allait évoluer spontanément dans le bon sens.
Alors je me suis renseignée ; dès que j’ai pu déchiffrer les écrits primitifs utilisés ici, je me suis plongée dans tous les textes qui pourraient m’indiquer qui je suis, quelle est mon authentique nature, pourquoi j’ai été envoyée sur cet astre et quelle aide je pourrais trouver. Ce fut un travail de longue haleine, les primates gonflés d’orgueil qui pullulent dans le coin ne s’intéressent qu’a leurs nombrils ; mais je tins bons et, indice après indice, détail après détail, je grattais la croute du mensonge et arrivai enfin à la cicatrice de la vérité. Les Voyageurs, un peuple très ancien et respectable a vu leur planète éjectée de son système suite à un cataclysme cosmique, et bien que leur prévoyance légendaire leur ait permis de survivre à une pareille odyssée, ils ne peuvent plus prospérer tant qu’ils sont prisonniers d’un monde privé de son étoile. Or, le présent caillou pourrait leur fournir une terre d’accueil correcte, en réalité l’unique accessible avant plusieurs siècles, à condition d’être débarrassée des nuisibles prétentieux qui en anéantissent le biome chaque jour.
Et c’est là que j’interviens : je suis l’Élue, celle envoyée en amont des Voyageurs pour leur apporter la Lumière dont ils ont été dépossédés depuis si longtemps, depuis trop longtemps, et qui pourtant leur revient de mérite sinon de droit et en tous cas bien plus qu’aux tarés autodestructeurs qui vivent ici, peut-être le seul peuple prétendument intelligent de l’univers dont l’obsession ultime de chaque génération est de faire pire que la précédente. Mais je m’égare, ainsi, ma mission est d’éliminer purement et simplement (quoique le « simplement » soit plus facile à dire qu’à faire) ces parasites pour laisser une planète propre et nette à ma véritable nation. Je savais d’instinct et de logique qu’ils ne m’auraient pas dépêchée isolée, sans aide ni outils pour parvenir à mes fins, les Voyageurs sont beaucoup trop sagaces et prévenants pour faire une telle erreur ; mon devoir suivant a donc été de rechercher cette aide et ou ces outils, tout en maintenant un comportement quotidien crédible pour une jeune fille censément de mon âge afin de ne pas griller ma couverture.
Comme je m’en doutais, ceux qui m’avaient envoyé ici m’avaient laissé divers indices subtils à travers des textes de diverses anciennetés ; j’acquis enfin la certitude que je devais travailler seule, sans doute parce que transférer une âme est un processus long, complexe et couteux tant en énergie qu’en ressources, mais je n’étais pas privée de moyens d’actions, bien au contraire : les Voyageurs m’avaient légué un rituel occulte qui me rendrait omnisciente, omnipotente et invulnérable, du moins dans les limites de cette planète, me permettant ainsi de mener mon projet à bien. J’étudiai donc cette cérémonie dans les moindres détails, pour ne rien laisser au hasard et apprêter ma mission au mieux, d’autant que je n’aurais pas de seconde chance et que les humains avaient réussi à théoriser, sinon détecter réellement, la présence de l’astre des Voyageurs dans leur espace intersidéral proche. J’affirme avec fierté que la préparation du rite fut aisée et que jamais l’un de ces singes stupides ne se douta de quoi que ce soit sans même que j’aie besoin de prendre des précautions extrêmes. Disposer les runes mystiques se révéla d’une simplicité enfantine, dresser l’autel consacré ne posa aucune difficulté d’aucune sorte, réaliser le poignard sacré demanda un peu de travail, mais sans contrariété particulière. Restai le problème du sang, car le rituel exige le sang d’un représentant de l’espèce sur laquelle on désire qu’il agisse, et pour une raison qui m’échappe encore, ceux qui s’appellent eux-mêmes « humains » sont très tatillons sur cette question et préfèrent que ce liquide ne se répande pas de son enveloppe naturelle.
La source la plus évidente que j’avais à ma disposition était un être nommé « Jacquemin », l’un des seuls, sinon l’unique humain presque sympathique que j’ai croisé dans tout mon séjour ici-bas, sans doute parce qu’il s’était lié à moi sans que j’en saisisse bien la cause, mais je ne m’en suis jamais plaint, puisqu’il m’a toujours été très pratique. C’est là que je dois confesser une faiblesse : j’ai du m’attacher à cet être bien plus que de raison, car arrivé le moment de prélever son sang (et il me parait important, pour bien comprendre la suite, de signaler que la quantité nécessaire ne laisse aucune chance de survie au donateur) je me surpris à douter. Je passai un weekend atroce, un lundi intégralement composé de questionnements et de peur : est-ce que j’avais bien tout prévu, est-ce que tous mes raisonnements étaient exacts ? Si oui, ce serait le début de ma gloire et de celle de tout mon peuple, mais si non, si jamais je me trompais sur le moindre élément, sur le plus minuscule détail, si jamais je n’étais pas véritablement une envoyée des Voyageurs, alors j’assassinerais une personne que je me découvris envisager comme un ami. Peut-être mon seul et unique proche, en vérité, mais à la réflexion je ne l’avais jamais réellement considéré comme tel bien que je m’appliquai à lui faire croire le contraire. Lui en tous cas s’était attaché à moi au point qu’il essaya de me joindre toute la journée, mais je ne pouvais pas lui faire part de mes doutes, il n’aurait jamais appréhendé, son intellect n’était pas calibré pour de telles révélations, même si je dois admettre qu’il était plutôt intelligent pour sa race. Et finalement il vint ici de lui-même, sans m’aviser, en réalité s’il m’avait prévenu toute la journée, mais je ne désirais pas le comprendre, et alors il était là, chez moi, devant moi, et je me suis sentie encore plus faible, plus fragile et plus indigne que jamais, et alors il m’a rassurée, pendant un instant j’ai même souhaité qu’il parte, je me suis dit que je trouverais un autre humain, un spécimen lambda dans la rue, mais le rituel était plus compliqué si je ne connaissais pas le donateur, alors j’avais besoin de lui, mais en même temps je ne désirais pas que ce soit lui, mes sentiments s’étaient tous mélangés et contradictoires comme ce mot bizarre qui veut dire rouge et vert à la fois ou celui qui indique qu’on invite et qu’on est invité et alors il a parlé, et j’ai su que les Voyageurs savaient et m’avaient ordonné de faire ce que j’avais à faire et que même si j’étais frêle et indigne et qu’il était ce que j’avais le plus proche d’un ami je devais le prélever.
Alors, il a saigné, et il n’a pas crié. C’est étrange. Il aurait dû crier, non ?
J’ai peur.
J’ai suivi le rituel, j’ai tracé les runes sacrées avec le sang, me suis débarrassée des accessoires de ce monde et peint les motifs occultes sur ma chair. Les forces cosmiques se concentrent, pendant ce temps j’écris cette lettre parce que j’ai peur, je suis terrifiée, parce que malgré toute ma préparation, malgré toutes mes lectures, il me reste cette infime parcelle de doute quant à la réalité des Voyageurs, même si ce n’est très probablement qu’un effet de bord de mon corps sur mon âme ; j’ai peur d’avoir commis une erreur et que le rituel ne se déroule pas exactement comme prévu et que les Voyageurs ne puissent pas recevoir la Terre Promise qui leur est due par ma faute ; j’ai peur parce que l’étape finale du rituel qui doit me donner des pouvoirs quasi divins, c’est de me planter le poignard sacré directement dans le cœur, ce qui rendrait fatale la moindre microscopique imprécision. C’est pour tout cela que, au cas où quelque chose n’irait pas à la perfection, et je vous prie, ô Voyageurs et tous les dieux de toutes les religions que ce ne soit pas le cas, c’est pour tout cela que, juste avant de passer à l’acte, je couche par écrit mon témoignage.
29 – Un pangolin
Les Dieux s’étaient créés les uns les autres, avaient créé la Terre et le Ciel, puis avaient créé le Temps. Puis, comme maintenant ils s’ennuyaient, ils avaient créé le hasard, les jeux, l’alcool et toutes les autres drogues ; et pour tromper cet ennui, entre autres distractions et deux beuveries, ils créaient la vie.
La soirée de la veille avait vu la création des autruches, des émeus et d’autres oiseaux incapables de voler ; une beuverie mémorable la semaine passée avait accouché de l’ornytorinque. Et cette nuit-là, l’un des Dieux avait parié qu’il serait capable de créer une bête viable à partir de toutes les contraintes que voudraient bien lui donner les autres.
— Pari tenu, dirent-ils, parce qu’ils étaient curieux et qu’ils n’avaient que ça à faire.
— Très bien, fit le parieur en se servant une généreuse rasade d’un nectar alcoolisé sans nom. Envoyez vos idées !
— Ça devra être un mammifère.
— Joli moyen d’imposer des contraintes fortes de forme et de viabilité, mais j’accepte. Qui d’autre ?
— Ça devra avoir des écailles.
— Comme celles d’un poisson ?
— Non, comme celles d’un cône de sapin ou d’épicéa.
— D’accord pour l’aspect, mais ça restera animal, pas végétal.
— Ça marche pour moi.
— Il deva mesurer environ 130 centimètres de long et peser environ 30 kilogrammes.
— Jusqu’ici, ça reste cohérent.
— Mais ça devra manger des fourmis.
— Et des termites !
Le dieu qui avait crié ça avait inventé ces insectes. Il était très fier des termitières et persuadé que son compère ne pourrait jamais imaginer quoi que ce soit de capable de les attaquer.
— Donc, des griffes très puissantes pour accéder à sa nourriture, dit le Dieu parieur. Hmmm, il ne va pas pouvoir marcher là-dessus, je vais lui mettre une très longue queue pour l’équilibre, et le faire se déplacer surtout sur ses pattes arrière. Avec ça, des dents pointues d’insectivore…
— Ha non, protesta l’inventeur des termites. Il a déjà les griffes, pas les dents !
— Toi, tu essaies de tricher, mais je te prends au mot. Donc, pas de dents… Ha ! Je sais, une longue langue gluante pour emprisonner les fourmis.
— Bien joué, fit quelqu’un dans l’assistance.
— Fais-toi plaisir.
— Je… j’exige que sa langue soit plus longue que son corps !, fit le créateur des termitières.
— Tu commences à abuser, mais c’est possible. Je ne tiens pas compte de la queue, évidemment.
— Tu triches !
— Et toi donc ? Tu veux qu’on organise un concours de mauvaise foi ? Rappelle-toi comment ça a fini la dernière fois !
— Ah non ! fit quelqu’un dans l’assistance. On a déjà assez d’imbécilités entre le matamata et la tortue alligator ! Si quelqu’un a de nouvelles idées, qu’il se signale.
— Moi ! Ça doit pouvoir se protéger en se mettant en boule comme un hérisson !
— Facile.
— Ça vivra dans des terriers, dit quelqu’un ;
— Ça grimpera aux arbres, dit un autre en même temps.
— Pourquoi pas les deux ? dit le parieur. Ça doit être possible, attendez quelques instants…
Il effectua quelques réglages, et présenta, satisfait, le résultat aux Dieux présents – du moins à ceux qui étaient encore assez lucides pour apprécier sa création.
— C’est pas mal, en effet. Comment vas-tu appeler ça ?
— Un pangolin.
— C’est joli. Je pense qu’on peut en faire un dérivé plus mignon. Avec des grands poils. Ça me donne une idée…
30 – Le clown le plus isolé au monde
Jean-Philippe consulta l’afficheur de son récepteur GPS, qui indiquait les 48° 52′ S, 123° 23′ O prévus, et mit son navire en panne. Il était au « point Nemo », pôle d’inaccessibilité maritime, ce qui faisait de lui et de l’équipage du petit navire les êtres humains les plus isolés de la planète. Enfin ! Après des semaines de navigation dans une mer démontée (qui passait pourtant pour calme dans ces quarantièmes rugissants), il allait pouvoir réaliser son rêve.
D’abord, en compagnie de l’huissier qui l’accompagnait dans ce périple, il vérifira sur les radars et cartes marines qu’aucun improbable navire ne s’était égaré dans cette zone perdue du Pacifique sud. Il consulta aussi les passages de la Station Spatiale Internationale, mais fort heureusement elle n’était pas attendue à proximité de la zone avant plusieurs heures.
— C’est à vous, maitre, dit Jean-Philippe.
— Merci. Je constate donc officiellement que toutes les conditions sont remplies pour que vous puissiez légalement devenir le clown le plus isolé du monde. Veuillez procéder, je vous prie.
Ému presque aux larmes, l’homme héla sa femme et son fils pour qu’ils puissent assister à l’accomplissement de son rêve.
Puis il s’habilla, se saisit de sa trousse de maquillage et d’un miroir et se peint la face.
— Au fait, où est Henri ? demanda-t-il, son nez rouge encore dans sa main.
— Il doit sans doute jouer dans sa cabine, répondit sa moitié. Je crains que ce record ne le passionne pas.
— Tant pis pour lui.
— Papa ! Regarde !
Le gamin déboula dans le carré, du maquillage plein le visage.
— Moi aussi je suis un clown !
Jean-Philippe, son nez rouge à la main, observa son fils, puis l’huissier, et de nouveau Henri et enfin l’homme de loi. Ce dernier afficha une mine contrite, mais ferme lorsqu’il annonça :
— Désolé, mais les règles sont formelles. Avec votre garçon, vous êtes deux. Vous n’êtes donc pas le clown le plus isolé du monde.
31 – Les jardins de la Mort
La Mort entretient d’immenses et splendides jardins, c’est un fait établi. « Comment un squelette encapuchonné pourrait-il jardiner », demandera sans doute le lecteur taquin. La vérité est simple : la Mort n’est pas un tel personnage, elle est un concept, que chacun se représente comme il l’entend – quoique celui qui y voit une figure attirante et sympathique doive s’interroger sur ses propres pulsions. La Mort, par nature, est née avec la vie et mourra avec elle. Elle ne connait pas le repos, mais comme le temps n’a littéralement aucune emprise sur elle, cela lui laisse tout le loisir de prendre soin de ses jardins.
Bien des scientifiques et des mystiques adoreraient visiter ces espaces. Certains pensent y trouver les âmes des défunts, mais ils ne pourraient pas se tromper de pire manière : la Mort ne s’occupe que du passage, ce qui advient des esprits après elle ne la regarde ni ne la concerne. Non, ses jardins ne contiennent que ce qui est mort, et définitivement mort, pour toujours et à jamais.
On y déniche une foultitude de biomes où gambadent et s’épanouissent dodos, moas, tigres de Bali, lions d’Europe et grizzli du Mexique, thylacine — chacun dans un environnement parfaitement adapté ; mais aussi des espèces bien plus anciennes, assez de dinosaures pour ravir tous les gamins et tous les amateurs de Jurassic Park. L’explosion cambrienne (et l’extinction qui s’en suivit) avait nécessité des aménagements considérables ; mais en réalité la majorité de l’espace est occupé par des espèces dont l’humanité n’a que très rarement conscience de leur existence : insectes, vers, éléments de plancton, plantes de toutes tailles… toutes ces choses qui ont vécu sur notre planète (mais pas sur d’autres, parce qu’elles sont sous la garde d’autres Morts).
Et pour l’heure, la Mort peste : une arrivée massive de nouveaux êtres lui donne beaucoup de travail. Elle peut tout à fait le gérer, le temps n’est pas important pour elle, mais elle déteste les heures supplémentaires imprévues. Hélas, depuis que l’humanité avait appris l’existence de ses jardins, elle prend un malin plaisir à lui envoyer autant de pensionnaires que possible. Pourtant, ce n’est pas un concours !
Alors, la Mort accueille toutes ces nouvelles espèces dans ses jardins, les choie comme il se doit, et espère pour que cesse cette gabegie que l’humain s’y présente bientôt.
comments powered by Disqus &
& 